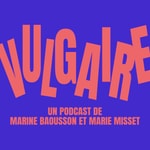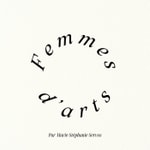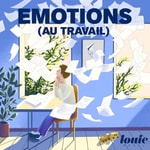FranceFineArt – Details, episodes & analysis
Podcast details
Technical and general information from the podcast's RSS feed.

FranceFineArt
FranceFineArt
Frequency: 1 episode/5d. Total Eps: 757

Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Recent rankings
Latest chart positions across Apple Podcasts and Spotify rankings.
Apple Podcasts
🇫🇷 France - arts
05/06/2025#90🇫🇷 France - arts
02/02/2025#95🇫🇷 France - arts
20/01/2025#81🇫🇷 France - arts
11/12/2024#93
Spotify
No recent rankings available
Shared links between episodes and podcasts
Links found in episode descriptions and other podcasts that share them.
See allRSS feed quality and score
Technical evaluation of the podcast's RSS feed quality and structure.
See allScore global : 59%
Publication history
Monthly episode publishing history over the past years.
🔊 “Modigliani / Zadkine” Une amitié interrompue au musée Zadkine, Paris du 14 novembre 2024 au 30 mars 2025
vendredi 6 décembre 2024 • Duration 14:47
du 14 novembre 2024 au 30 mars 2025
par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 2 décembre 2024, durée 14’48,
© FranceFineArt.
https://francefineart.com/2024/12/06/3578_modigliani-zadkine_musee-zadkine/
Communiqué de presse
Commissariat :
Cécilie Champy-Vinas, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée Zadkine
Thierry Dufrêne, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université Paris Nanterre
Avec la collaboration d’Anne-Cécile Moheng, attachée de conservation au musée Zadkine
Après l’exposition dédiée à Chana Orloff, le musée Zadkine continue d’explorer les liens artistiques tissés par Zadkine au cours de sa vie. Cette exposition est la première à s’intéresser à une amitié artistique jamais explorée jusqu’alors, celle qui unit le sculpteur Ossip Zadkine au peintre Amedeo Modigliani.
À travers près de 90 oeuvres, peintures, dessins, sculptures mais également documents et photographies d’époque, elle propose de suivre les parcours croisés de Modigliani et Zadkine, dans le contexte mouvementé et fécond du Montparnasse des années 1910 à 1920. Bénéficiant de prêts exceptionnels de grandes institutions – le Centre Pompidou, le musée de l’Orangerie, les musées de Milan, Rouen et Dijon – ainsi que de prêteurs privés, le parcours fait se confronter, comme au temps de leurs débuts artistiques, deux artistes majeurs des avant-gardes, et permet de renouer les fils d’une amitié interrompue.
Ossip Zadkine rencontre Amedeo Modigliani en 1913 : les deux artistes, fraîchement débarqués à Paris, rêvent chacun de devenir sculpteurs et partagent alors le « temps des vaches maigres » comme l’écrira Zadkine dans ses souvenirs. Cette amitié, aussi brève que féconde sur le plan artistique, est interrompue par la Première Guerre mondiale. Modigliani abandonne la sculpture pour la peinture, sur le conseil de marchands. Zadkine s’engage comme brancardier en 1915, avant d’être gazé et d’entamer une longue convalescence. Les deux artistes se retrouvent brièvement au sortir de la guerre, avant que leurs voies ne divergent à nouveau. Modigliani connaît un succès croissant avec ses peintures, mais il meurt prématurément à 35 ans, en 1920, tandis que Zadkine entame une longue et fructueuse carrière de sculpteur. Zadkine n’oubliera pas Modigliani et conservera précieusement le portrait fait par son ancien camarade, dont la gloire posthume ne fait que croître, à tel point que « Modi » devient l’une des figures mythiques de l’art moderne.
L’exposition fait dialoguer, pour la première fois, les oeuvres de Modigliani et de Zadkine, mettant en évidence leur parenté d’inspiration mais également leurs divergences. Le parcours retrace, en cinq sections, les étapes d’une amitié d’exception, depuis les débuts parisiens des deux artistes jusqu’à la mort de Modigliani en janvier 1920. Il met en avant les cercles de sociabilité communs des deux artistes à Montparnasse, ainsi que le rôle pris par Zadkine dans l’édification posthume du mythe Modigliani. La dernière section interroge le rapport des deux artistes à l’architecture et offre une évocation spectaculaire du projet de temple à l’Humanité, rêvé par Modigliani.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
🔊 “Figures du fou” Du Moyen Age aux romantiques au Louvre – Hall Napoléon, Paris du 16 octobre 2024 au 3 février 2025
mardi 3 décembre 2024 • Duration 27:54
du 16 octobre 2024 au 3 février 2025
par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 2 décembre 2024, durée 27’55,
© FranceFineArt.
https://francefineart.com/2024/12/06/3577_figures-du-fou_le-louvre/
Communiqué de presse
Commissariat :
Élisabeth Antoine-König, conservatrice générale au département des Objets d’art, musée du Louvre
Pierre-Yves Le Pogam, conservateur général au département des Sculptures, musée du Louvre
Les fous sont partout. Mais les fous d’hier sont-ils ceux d’aujourd’hui ? Le musée du Louvre consacre cet automne une exposition inédite à ces multiples figures du fou, qu foisonnent dans l’univers visuel du XIIIe au XVIe siècle. Manuscrits enluminés, livres imprimés et gravures, tapisseries, peintures, sculptures, objets précieux ou du quotidien : entre Moyen Âge et Renaissance, le fou envahit littéralement tout l’espace artistique et s’impose comme une figure fascinante, trouble et subversive dans une époque de ruptures, pas si éloignée de la nôtre.
L’exposition interroge cette omniprésence des fous dans l’art et la culture occidentale à la fin du Moyen Âge : que signifient ces fous, qui paraissent jouer un rôle-clé dans le passage aux temps modernes ? Si le fou fait rire et amène avec lui un univers plein de bouffonneries, apparaissent également des dimensions érotiques, scatologiques, tragiques et violentes. Capable du meilleur comme du pire, le fou est tour à tour celui qui divertit, met en garde, dénonce, inverse les valeurs, voire même renverse l’ordre établi.
Réunissant dans l’espace du hall Napoléon entièrement rénové plus de trois cents oeuvres, prêtées par 90 institutions françaises, européennes et américaines, l’exposition propose un parcours exceptionnel dans l’art de l’Europe du Nord (mondes flamand, germanique, anglo-saxon et français surtout) et met en lumière un Moyen Âge profane, passionnant et bien plus complexe qu’on ne le croit. Elle explore également la disparition du fou lorsque triomphent la Raison et les Lumières, avant une résurgence à la fin du XVIIIe siècle et pendant le XIXe siècle. Le fou devient alors la figure à laquelle les artistes s’identifient : « Et si le fou, c’était moi ?»
[...]
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
🔊 “CORPS IN·VISIBLES” au Musée Rodin, Paris du 15 octobre 2024 au 2 mars 2025
lundi 14 octobre 2024 • Duration 16:30
“CORPS IN·VISIBLES”au Musée Rodin, Paris
du 15 octobre 2024 au 2 mars 2025
par Anne-Frédérique Fer, à Paris,14 octobre 2024, durée 16’30,
© FranceFineArt.
https://francefineart.com/2024/10/19/3565_corps-in-visibles_musee-rodin/
Communiqué de presse
Commissariat #corpsinvisibles
Marine Kisiel, conservatrice du département mode XIXe siècle du Palais Galliera, musée de la Mode de Paris
Isabelle Collet, conservatrice générale, cheffe du département scientifique et des collections du musée Rodin.
Une exposition organisée avec la collaboration exceptionnelle du Palais Galliera, musée de la Mode de Paris, et avec le concours de l’Institut de France.
À l’automne 2024, le musée Rodin met à l’honneur une pièce méconnue de ses collections, l’Étude de robe de chambre pour Balzac d’Auguste Rodin. Conçue à partir d’une sélection de sculptures issues des collections du musée, de pièces de mode du XIXe siècle du Palais Galliera et d’archives inédites de la bibliothèque de l’Institut de France, l’exposition intitulée Corps In·visibles déplie, à partir de la singulière Robe de chambre, une enquête sur la recherche d’un corps de Balzac par Rodin. Cette investigation est un véritable prélude à une réflexion sur les corps — réels, idéalisés, statufiés et occultés – dans la statuaire monumentale du XIXe siècle qui peuplent toujours notre monde contemporain.
Le corps de Balzac, tel que Rodin l’appréhende par le vêtement, lorsqu’il fait refaire un costume du romancier disparu par le tailleur de Balzac, révèle de l’homme son physique considéré comme peu avantageux par les commanditaires du monument : Balzac, en un mot, était gros. Faisant dialoguer couture et sculpture, et rapprochant la pratique des tailleurs de celle des statuaires, l’exposition observe comment la perception des corps influence la fabrique de leur image de bronze, fortement idéalisée. Elle révèle combien le mythe de Balzac écrivant en robe de chambre permet finalement à Rodin de cacher sous d’amples plis un corps refusé en raison de sa corpulence. L’exposition « Corps In·visibles » invite, ce faisant, à réfléchir à la représentation des corps dans l’espace public, et au nécessaire élargissement contemporain de ces représentations.
Retrouver un corps
Choisi par la Société des Gens de Lettres en 1891 pour sculpter un monument à Balzac, Auguste Rodin se lance dans la quête du romancier disparu depuis près d’un demi-siècle : de l’étude de l’image de Balzac à Bruxelles chez un collectionneur de reliques balzaciennes, à la recherche de son corps dans la Touraine natale de l’écrivain où Rodin trouve pour modèle un charretier corpulent, les étapes de cette enquête sont restituées au fil de l’exposition. Fait largement inconnu, Rodin retrouve même le tailleur de Balzac et lui fait refaire un costume de l’écrivain pour mieux en comprendre la physionomie. Les visiteurs pourront ainsi découvrir la redingote de Balzac, retaillée pour l’occasion à partir des mesures réelles et inédites de son corps.
[...]
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
🔊 “Arina Essipowitsch” Déplier l’imageau Jeu de Paume – Château de Tours, Tours du 23 juin au 29 octobre 2023
samedi 24 juin 2023 • Duration 12:41
du 23 juin au 29 octobre 2023
par Anne-Frédérique Fer, à Tours, le 22 juin 2023, durée 12’41,
© FranceFineArt.
https://francefineart.com/2023/06/24/3463_arina-essipowitsch_jeu-de-paume_chateau-de-tours/
Communiqué de presse
Commissariat :
Marta Ponsa, responsable des projets artistiques du Jeu de Paume, commissaire d’expositions et programmatrice de cinéma.
Raphaëlle Bracq, diplômée en histoire de l’art contemporain et en droit.
Le Jeu de Paume présente, au Château de Tours, une exposition consacrée à la photographe Arina Essipowitsch. Déplier l’image dévoile une série de photographies inédite réalisée par l’artiste dans la Loire et ses environs. S’inspirant du fleuve et de ses méandres, son oeuvre invite à voyager dans la vallée, depuis ses éléments minéraux et aquatiques jusqu’à son patrimoine architectural local, qui l’inspirent et la nourrissent. À l’occasion de cette exposition, le Château de Tours accueille une performance de l’artiste, invitée à réaliser une oeuvre in situ.
Née à Minsk en 1984, Arina Essipowitsch réalise des études d’art à Aix-en-Provence et Dresde en Allemagne. Elle travaille entre Berlin et Aix-en-Provence, son lieu de résidence actuel. Ses oeuvres ont fait l’objet de plusieurs expositions dans des musées, institutions et espaces d’art. En 2021, elle est invitée par le Jeu de Paume Lab Instagram, un compte entièrement dédié à la création contemporaine.
L’oeuvre d’Arina Essipowitsch est comme un jeu qui semble vouloir épuiser l’ensemble des possibilités physiques de la photographie, perdant le spectateur dans les échelles, les plis et coupes, passant d’un détail à un autre afin de tenter de restituer l’entièreté d’une histoire sensible et introspective.
À travers ses photographies, l’artiste explore les notions d’identité et de déplacement, liées à son parcours de vie. Ses images saisissent des moments de son intimité avec les surfaces sensibles qu’elle habite : le sable, les rochers, les écorces ou les murs, avec le souhait de les faire perdurer dans le temps.
Sa démarche n’envisage cependant pas de documenter ces espaces mais de souligner de manière palpable l’expérience temporelle nécessaire à tout regard. Certaines de ses oeuvres donnent à voir un autoportrait, dans les images de ses paysages ou sur la surface des éléments naturels.
Le parcours de l’exposition s’ouvre sur une performance de l’artiste, invitée par le Jeu de Paume au Château de Tours à produire une nouvelle oeuvre. Conçue lors de sa résidence au POLAU, Méandre est une pièce de grand format à modules dont le parcours de dépliage imite les sinuosités de la Loire.
Cette photographie est olfactive. En se déplaçant dans l’espace d’exposition par l’activation de l’artiste, elle révèle à nos sens les éléments aquatiques et minéraux qui composent le fleuve. Tandis que la performance, réalisée au lancement de l’exposition, est dévoilée à travers une vidéo documentaire projetée dans les salles, la pièce est activée tous les samedis à 11h par une conférencière.
Les sections suivantes dévoilent des photographies présentées pour la plupart fragmentées, coupées en modules réguliers. L’artiste les plie et déplie avec la volonté de prolonger le temps de notre perception devant l’image. Une seule image est démultipliée, change de taille pour devenir tridimensionnelle ou est découpée en petits pliages que l’artiste conserve et porte avec elle comme un album de famille tels des fragments choisis de sa propre mémoire et de son histoire.
[...]
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
🔊“Julien Magre” En vieau Jeu de Paume – Château de Tours, Tours du 23 juin au 29 octobre 2023
vendredi 23 juin 2023 • Duration 13:10
du 23 juin au 29 octobre 2023
par Anne-Frédérique Fer, à Tours, le 22 juin 2023, durée 13’11,
© FranceFineArt.
https://francefineart.com/2023/06/24/3462_julien-magre_jeu-de-paume_chateau-de-tours/
Communiqué de presse
Commissariat :
Julien Magre avec la collaboration de Quentin Bajac, directeur du Jeu de Paume
Le Jeu de Paume met à l’honneur, au Château de Tours, le photographe Julien Magre, lauréat du Prix Niépce de Gens d’images 2022. L’exposition présente « En vie », un corpus de 50 tirages, à travers lesquels l’artiste documente son quotidien de 1999 à 2020. Derrière son objectif, il immortalise des scènes de famille : les portraits de sa compagne aux premiers temps de leur relation, les photographies de ses deux filles, jusqu’à ce que l’une d’elles s’éteigne, puis les images de son fils, le dernier né. Le Jeu de Paume présente à cette occasion des oeuvres inédites, produites tout spécialement pour cette exposition.
Né en 1973, Julien Magre vit et travaille à Paris. Diplômé des Arts Décoratifs de Paris en 2000, son travail est représenté par la galerie Le Réverbère à Lyon depuis 2017. À Paris Photo en 2010, Agnès b. repère son travail lors de la signature de Caroline, Histoire numéro deux (Filigranes, 2010). En parlant de ce projet qu’il mène maintenant depuis quinze ans, le photographe se dit « spectateur de [sa] propre intimité » : choisissant la bonne distance avec son sujet, ni trop loin, ni trop près, il documente son quotidien, et par là même le rend poétique. Je n’ai plus peur du noir (Filigranes, 2016) fait partie des 10 meilleurs livres sélectionnés par le Prix Nadar 2017 ainsi que de la short-list livres d’auteur aux Rencontres d’Arles 2017. En 2022, il est l’un des lauréats de « La grande commande photographique du ministère de la Culture » initiée par la BnF.
Dévoilés dans cette exposition, les tirages appartenant au corpus « En vie » s’étalent sur près de 20 ans de la vie de Julien Magre : ils sont présentés selon un ordre chronologique, de 1999 à 2020. Inaugurant cet ensemble, la première image représente Caroline, la femme de l’artiste, en 1999. Puis, toujours avec poésie et humilité, l’artiste cristallise des fragments d’intimité de ses deux filles Louise et Suzanne, entre 2004 et 2007. Après le décès tragique de Suzanne en 2015, il continue à photographier Caroline, Louise puis Paul, son troisième enfant qui naît le 3 janvier 2019 et qui symbolise pour lui la reconstruction.
Au fil de ses oeuvres, Julien Magre capture avec tendresse le temps qui passe. L’intimité dévoilée n’est jamais simple, puisqu’il prend grand soin de dissimuler toutes les parcelles de sa vie et opère ainsi une transfiguration de la banalité quotidienne. En Vie affirme la capacité du médium photographique à immortaliser chaque instant, jusqu’à faire ressentir un sentiment d’appartenance et de proximité, jusqu’à faire tendre les choses simples vers l’universel.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
🔊 “Pol Taburet” OPERA III: ZOOà Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, Paris du 21 juin au 3 septembre 2023
mercredi 21 juin 2023 • Duration 13:53
du 21 juin au 3 septembre 2023
par Anne-Frédérique Fer,à Paris, le 20 juin 2023, durée 13’54,
© FranceFineArt.
https://francefineart.com/2023/06/22/3461_pol-taburet_lafayette-anticipations/
Communiqué de presse
Commissaire : Elsa Coustou
Directrice de Lafayette Anticipations : Rebecca Lamarche-Vadel
OPERA III: ZOO “The Day of Heaven and Hell” est la première exposition monographique en institution de Pol Taburet. Né en 1997, l’artiste y présente des peintures et explore de nouveaux médiums comme la sculpture et l’installation. Pour beaucoup inédites, les oeuvres créent un parcours qui se déploie, de scènes en scènes, dans l’ensemble de la Fondation.
Lafayette Anticipations se métamorphose en un intérieur domestique habité de visions qui nous plongent dans une réalité proche de l’hallucination. Puisant dans une mythologie tant personnelle que collective, les contes, les dessins animés et l’histoire de l’art, les œuvres de Pol Taburet présentées dans cette exposition s’inspirent de l’imaginaire de l’enfance et de sa capacité à créer des mondes.
L’architecture se charge de présences, l’inanimé prend vie, le monstrueux se cache dans l’ombre et les émotions prennent corps. Les figures surgissent des peintures et des sculptures telles des spectres, des corps pris dans les lumières artificielles d’un salon, d’un théâtre, d’un club de strip-tease. Nés dans l’intimité – celle de l’espace domestique mais aussi du souvenir, du rêve ou encore du fantasme -, ces « personnages-esprits » s’en échappent pour venir animer l’ensemble des espaces de la Fondation.
Au fil de l’exposition, l’étrange se mêle au familier et les oeuvres inventent un bestiaire humain. Quels sont les pulsions, les visions et les désirs qui animent nos esprits et nos corps dans l’intimité ? Le travail de Pol Taburet se propose de sonder les profondeurs de l’être et ses territoires invisibles, inavouables ou indomptables.
OPERA III: ZOO “The Day of Heaven and Hell” constitue le nouvel acte d’un cycle dédié aux pouvoirs de l’imagination, ici suspendue quelque part entre le paradis et l’enfer.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
🔊 “Jacobus Vrel” énigmatique précurseur de Vermeerà la Fondation Custodia, Paris du 17 juin au 17 septembre 2023
dimanche 18 juin 2023 • Duration 19:15
du 17 juin au 17 septembre 2023
par Anne-Frédérique Fer,à Paris, le 16 juin 2023, durée 19’15,
© FranceFineArt.
https://francefineart.com/2023/06/18/3459_jacobus-vrel_fondation-custodia/
Communiqué de presse
Commissariat :
Cécile Tainturier, conservatrice, Fondation Custodia
Quentin Buvelot, conservateur, Mauritshuis – Cabinet royal de peintures à La Haye
Après une étape initiale au Mauritshuis – Cabinet royal de peintures à La Haye, la Fondation Custodia accueille du 17 juin au 17 septembre 2023 l’exposition Jacobus Vrel, énigmatique précurseur de Vermeer. Cette première présentation monographique consacrée au peintre rassemble ses œuvres majeures disséminées dans les plus grands musées – Amsterdam, Bruxelles, Détroit, Munich, Vienne… – et dans de prestigieuses collections particulières. On y verra aussi, bien entendu, l’une des scènes de genre les plus connues et surprenantes du peintre qui est conservée à la Fondation Custodia. Cet évènement se tient en parallèle de l’exposition Rein Dool. Les dessins, présentée Auparavant au Dordrechts Museum.
L’étape parisienne de l’exposition sera très différente de celle du Mauritshuis car la sélection d’oeuvres de Jacobus Vrel a été enrichie de neuf tableaux et de l’unique dessin connu de l’artiste. Ce dernier se devait d’être présent dans les salles de la « maison de l’art sur papier » ainsi que Ger Luijten, notre regretté directeur, aimait à décrire la Fondation. En outre, la Fondation Custodia proposera une immersion dans le Siècle d’or hollandais afin de mettre en relief l’originalité de Vrel : un choix de tableaux, de dessins et de gravures issues de sa propre collection sera complété par de très beaux prêts de la Alte Pinakothek de Munich, du Mauritshuis, du Rijksmuseum et d’autres musées néerlandais.
À première vue, rien ne semble relier Jacobus Vrel au célèbre Johannes Vermeer hormis leurs initiales « JV ». Pourtant, nombre de leurs tableaux partagent un même calme contemplatif, le rôle central joué par des figures féminines et, bien souvent, un certain mystère. Ainsi, beaucoup d’oeuvres de Jacobus Vrel furent longtemps attribuées à Vermeer. Inconnues du grand public, elles intriguent et fascinent les historiens d’art depuis plus d’un siècle. Qui était donc ce mystérieux peintre du XVIIe siècle hollandais ?
Vrel l’énigmatique
Rien n’est connu de la vie de Jacobus Vrel. Seul un de ses tableaux porte une date : « 1654 », que l’on peut lire dans la partie gauche de la Femme à la fenêtre de Vienne, juste après le nom « J. Frel ». Ici, la signature de Vrel ne se détache pas sur le blanc d’un morceau de papier tombé sur le sol de la composition, contrairement à la majorité de ses scènes d’intérieur. Car Jacobus Vrel a signé ou monogrammé presque toutes ses oeuvres connues. Étrangement – mais tout semble étrange chez Vrel – il orthographie son patronyme de façons très variées : « J. Frel », comme à Vienne, « Vrel », « Vrell », « Vrelle », voire « Veerlle ». Dans l’intérieur d’église et la Vieille femme lisant, il donne également son prénom en toutes lettres : « Jacobüs Vreel ». On ne connaît que cinquante oeuvres de sa main : un unique dessin et quarante-neuf tableaux, tous peints sur panneaux de bois. Le catalogue raisonné établi par l’équipe scientifique internationale qui a porté ce projet les a tous répertoriés dans la monographie consacrée à Jacobus Vrel, publiée au printemps 2021. [...]
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
🔊 “Johan van der Keuken” Le rythme des imagesau Jeu de Paume, Paris du 16 juin au 17 septembre 2023
vendredi 16 juin 2023 • Duration 21:02
du 16 juin au 17 septembre 2023
par Anne-Frédérique Fer,à Paris, le 15 juin 2023, durée 21’03,
© FranceFineArt.
https://francefineart.com/2023/06/16/3458_johan-van-der-keuken_jeu-de-paume/
Communiqué de presse
Commissaires :
Frits Gierstberg, commissaire au Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
Pia Viewing, commissaire au Jeu de Paume pour l’étape parisienne
Le Jeu de Paume rend hommage au photographe et cinéaste néerlandais Johan van der Keuken à travers une grande rétrospective, présentée du 16 juin au 17 septembre 2023. « Le rythme des images » présente plus d’une centaine de tirages d’époque de Johan van der Keuken provenant de collections néerlandaises et françaises, placées en dialogue avec une sélection de ses courts-métrages. Hormis ses nombreux long-métrages inadaptés au format de l’exposition, elle couvre l’ensemble de son oeuvre, de 1955 à 2000. On y découvre également, pour la première fois en France, les maquettes originales de certains de ses premiers livres photographiques. Cette exposition permet ainsi de saisir le sens aigu de l’observation de Van der Keuken et son désir profond de représenter un contact très direct, impulsif et parfois violent avec la réalité.
Johan van der Keuken est né en 1938 à Amsterdam. Il a 12 ans lorsqu’il est initié à la photographie et à seulement 17 ans, il publie son premier livre de photos. Un an plus tard, il intègre l’IDHEC (Institut des Hautes Études Cinématographiques) à Paris. Dans la capitale, il prend des milliers de clichés, la ville servant de toile de fond à ses sentiments d’errance et de désolation, dont résulte le livre Paris Mortel, qu’il publie en 1963. C’est aussi durant cette période qu’il tend vers le cinéma et conçoit ses premiers films. Entre 1960 et 2000, il réalise environ 50 films – courts, moyens et longs métrages mais aussi documentaires – où s’entremêlent fiction, reportage et intimité, interrogeant sans cesse la perception de la réalité. Il décède en 2001 à Amsterdam.
Johan van der Keuken acquiert une renommée internationale grâce à son oeuvre cinématographique et photographique. Son travail, à la frontière entre le documentaire et l’expérimental, se caractérise par une relation étroite avec le réel.
Pour cette exposition, des tirages vintages issus de collections néerlandaises ou de prêts de la Maison européenne de la photographie, sont présentés aux côtés de films, livres et écrits. Le parcours, thématique, confronte l’oeuvre photographique de l’artiste et une sélection de courts métrages, révélant la spécificité de son oeuvre au fil des salles.
Réalisés dans les années 1950 et 1960, les livres photos – Wij zijn 17 (Nous avons 17 ans), 1955 et Achter glas (Derrière la vitre), 1958 – oeuvres de référence célébrées pour leur qualité poétique et leurs montages saisissants, inaugurent l’exposition. Cette première partie présente des tirages d’époque, mais également des épreuves de mise en page et des maquettes originales des livres, jamais dévoilées en France, qui révèlent le processus technique et artistique du photographe. Ces deux premières séries sont composées de portraits individuels de ses amis. Son entourage, d’Ed van der Elsken au célèbre poète néerlandais Lucebert, fondateur du mouvement littéraire Vijftigers, le soutient et l’inspire : la musicalité de la poésie, l’éclatement de la narration et les associations inventives entre les mots le conduisent à développer une approche expérimentale de l’image, ici dévoilée.
[...]
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
🔊 “Frank Horvat” Paris, le monde, la modeau Jeu de Paume, Paris du 16 juin au 17 septembre 2023
jeudi 15 juin 2023 • Duration 18:24
du 16 juin au 17 septembre 2023
par Anne-Frédérique Fer,à Paris, le 15 juin 2023, durée 18’24,
© FranceFineArt.
https://francefineart.com/2023/06/15/3457_frank-horvat_jeu-de-paume/
Communiqué de presse
Commissariat : Virginie Chardin, commissaire d’exposition indépendante
Le Jeu de Paume présente la plus grande exposition consacrée au photographe Frank Horvat depuis son décès le 21 octobre 2020. À travers 170 tirages et 70 documents d’archive, « Frank Horvat. Paris, le monde, la mode » se concentre sur les quinze premières années d’une carrière exceptionnelle. Entre 1950 et 1965, Horvat affirme une personnalité hors norme d’auteur-reporter et de photographe de mode. L’exposition apporte une vision renouvelée sur l’oeuvre de cet acteur majeur de la photographie française et européenne.
Né à Abbazia en Italie en 1928, de parents juifs originaires d’Europe Centrale, Francesco Horvat est contraint de se réfugier en 1939 en Suisse, près de Lugano, avec sa mère et sa soeur. Parti pour Milan après la guerre, il s’essaie au métier de publicitaire puis de photographe. Ses premières images sont publiées au début des années 1950 par les journaux italiens et suisses Epoca, Die Woche et Sie und Er. Admirateur d’Henri Cartier-Bresson auquel il rend visite à Paris en 1951 dans l’espoir d’intégrer l’agence Magnum, il acquiert un Leica et effectue un premier voyage initiatique au Pakistan et en Inde de 1952 à 1954. Parvenant à capter en gros plans des scènes d’une grande intensité et parfois des lieux interdits, il se révèle comme un photographe du corps et de l’intime.
À la suite de Die Woche, les grands magazines internationaux Paris-Match, Picture Post, Le Ore ou Life le publient sous le nom de Franco, puis de Frank Horvat, et Edward Steichen sélectionne une de ses images du Pakistan pour la célèbre exposition The Family of Man au Musée d’art moderne de New York (MoMA). Sa carrière de photo-reporter se poursuit à Londres et à Paris où il s’installe fin 1955. Dans ses reportages sur les nuits parisiennes, strip-tease, cabarets, music-halls voire lieux de prostitution, il capte autant l’attitude des spectateurs-voyeurs que le spectacle lui-même.
C’est à cette période qu’il acquiert un téléobjectif Novoflex et s’essaie à un grand nombre de points de vue inédits sur Paris, exacerbant par un effet de grain, de contraste et d’écrasement des plans, la saturation de l’espace public et l’anonymat de la foule. Romeo Martinez, éditeur et rédacteur-en-chef de la revue Camera, consacre vingt pages à ce travail dans le numéro de janvier 1957 et l’expose à la Première Biennale de Photographie de Venise la même année.
Ce sont ces images de rue, reprises dans plusieurs revues photographiques européennes, qui paradoxalement, le conduisent vers l’univers de la mode. Par l’intermédiaire de William Klein, qui a remarqué ses images dans Camera, il entre en relation avec Jacques Moutin, le directeur artistique de Jardin des Modes.
Ce dernier lui propose de transposer son style de photographie urbaine, granuleuse, en lumière naturelle et en petit format, dans la mise en scène des collections de mode et particulièrement du prêt-à-porter, alors en pleine explosion. C’est grâce à lui qu’il réalise ses images les plus célèbres, comme Tan Arnold au Chien qui fume ou celle de la femme au chapeau Givenchy observant aux jumelles une course imaginaire. [....]
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
🔊 “Harry Gruyaert” La part des chosesLE BAL, Paris du 15 juin au 24 septembre 2023
jeudi 15 juin 2023 • Duration 16:45
du 15 juin au 24 septembre 2023
par Anne-Frédérique Fer,à Paris, le 14 juin 2023, durée 16’46,
© FranceFineArt.
https://francefineart.com/2023/06/15/3456_harry-gruyaert_le-bal/
Communiqué de presse
Commissaire de l’exposition : Diane Dufour, directrice du LE BAL
Photographe né à Anvers en 1941, Harry Gruyaert est un des pionniers de la photographie couleur, au même titre que les grands américains qu’il a très tôt vus et aimés, Joel Meyerowitz, William Eggleston ou Stephen Shore. Loin de sa Belgique natale trop étriquée, le New York du début des années 1970 l’expose au Pop Art et « à regarder autrement la banalité, à accepter une sorte de laideur du monde et à en faire quelque chose ». Ses amitiés avec la nouvelle scène new-yorkaise (Gordon Matta-Clark, Richard Nonas) confortent ce que Le Désert rouge d’Antonioni, « vu mille fois », avait déjà distillé en lui : le besoin d’arpenter le monde, de s’y jeter avidement, non pour le désigner ou nous en informer mais pour le sculpter, le modeler. Transcrire sa perception des choses et non les choses elles-mêmes. Se faire voyant, pas témoin.
Harry Gruyaert a dit cette lutte physique, ce corps à corps avec les choses et les êtres : « Je me jette dans les choses pour éprouver ce mystère, cette alchimie : les choses m’attirent et j’attire les choses ». Dans la bande passante de la vie, alors que tout se dérobe et échappe et pour que « tout tombe en place », il faut être à la fois plus là et moins là, s’oublier soi-même pour saisir la matière, la texture, tout ce qui fait l’ici et le maintenant ; se soumettre, tout en en cultivant la prescience, à un ordonnancement instinctif des formes, couleurs, symboles, lumières, motifs.
Alain Bergala dans Correspondance new-yorkaise distingue deux types de photographes : celui qui croit en la réalité et fait de la photographie un art de la présence et celui qui vit le réel comme impossible et ne fait que fixer l’absence. À l’aune de cette distinction, Harry Gruyaert serait une anomalie, un photographe dont la présence viscérale au monde vise avant tout à en saisir le caractère fugitif, intangible. Des trajectoires isolées, des espaces disjoints, des corps en périphérie, tout concourt dans ses images à rendre l’absurdité du monde, le collage surréaliste de la vie et ses morceaux détachés.
Photographier peut donc aussi être cela : communier avec un état de solitude et dire un mensonge plus vrai que la vérité.
Diane Dufour
« Je me dis parfois qu’il serait tellement plus simple de mettre en scène mes images, de repeindre tel mur comme Antonioni, ou de demander à tel personnage de s’habiller autrement. Mais je crois que j’y perdrai ce miracle instantané de l’inattendu qui coupe le souffle, de ce phénomène très physique de la photo qui soudain s’inscrit. » – Harry Gruyaert
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.