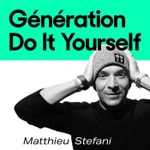Nouveau Départ – Details, episodes & analysis
Podcast details
Technical and general information from the podcast's RSS feed.

Nouveau Départ
Laetitia Vitaud & Nicolas Colin
Frequency: 1 episode/8d. Total Eps: 235

Recent rankings
Latest chart positions across Apple Podcasts and Spotify rankings.
Apple Podcasts
🇫🇷 France - newsCommentary
31/07/2025#46🇫🇷 France - newsCommentary
26/07/2025#97🇫🇷 France - newsCommentary
25/07/2025#75🇫🇷 France - newsCommentary
24/07/2025#46🇫🇷 France - newsCommentary
21/07/2025#80🇫🇷 France - newsCommentary
20/07/2025#46🇫🇷 France - newsCommentary
02/07/2025#93🇫🇷 France - newsCommentary
01/07/2025#76🇫🇷 France - newsCommentary
30/06/2025#48🇫🇷 France - newsCommentary
25/06/2025#96
Spotify
No recent rankings available
Shared links between episodes and podcasts
Links found in episode descriptions and other podcasts that share them.
See all- https://twitter.com/_NouveauDepart_
217 shares
- https://twitter.com/Vitolae
198 shares
- https://twitter.com/Nicolas_Colin
190 shares
RSS feed quality and score
Technical evaluation of the podcast's RSS feed quality and structure.
See allScore global : 59%
Publication history
Monthly episode publishing history over the past years.
Les batailles de la natalité
jeudi 12 septembre 2024 • Duration 01:17:26
Le podcast Nouveau Départ de cette semaine parle de natalité et de démographie. Julien Damon, enseignant à Sciences-Po et à HEC, conseiller scientifique de l’École nationale supérieure de Sécurité sociale (En3s) et rédacteur en chef de la revue Constructif, est un auteur prolifique, dont le dernier ouvrage, intitulé Les batailles de la natalité. Quel « réarmement démographique » ? vient de paraître aux éditions de L’Aube. Il y analyse les causes multiples de la baisse de la fécondité et les politiques familiales et il propose quelques pistes pour les réactualiser.
Rhétorique guerrière et vocabulaire militaire accompagnent depuis longtemps le natalisme à la française. À partir de la fin du XIXe siècle, le souci de repopulation, au moins de lutte contre la dépopulation, irrigue les discours politiques. La France explique sa défaite dans la guerre de 1870-1871, en partie, par la supériorité démographique prussienne. Les débats parlementaires et les tribunes dans la presse de l’époque évoquent profusément une mobilisation générale et un devoir moral, pour faire des enfants. Des innovations institutionnelles jettent les bases de politiques à vocation nataliste. (Les batailles de la natalité, Julien Damon)
Au fil de notre conversation, nous discutons avec Julien :
* de la polémique engendrée par l’expression macronienne « réarmement démographique » et de ses sources historiques ;
* du décalage entre le choix individuel et intime de faire (ou pas) un enfant et le focus collectif sur la natalité (soldats, contribuables, travailleurs pour la nation) ;
* de la baisse de la natalité et de la transition démographique ;
* des indicateurs — l’indice conjoncturel de fécondité et la descendance finale ;
* du fait que l’égalité parentale et domestique n’a pas suivi la (relativement) meilleure égalité femmes-hommes dans la sphère professionnelle ;
* des « no kids » et du (non) désir d’enfants ;
* de l’accès au logement et de la pénalité maternelle ;
* des allocations familiales et de la préférence française pour les familles nombreuses ;
* du quotient familial ;
* des familles recomposées et des familles homoparentales ;
* du soutien aux pères / aux seconds parents…
📚 Les batailles de la natalité : le dernier ouvrage de Julien Damon (L’Aube, 2024)
Toilettes publiques : histoire et politique (avec Julien Damon) 🎧
Un Nobel contre la pénalité maternelle (conversation « À deux voix ») 🎧
Faut-il être jeune pour innover ? (conversation « À deux voix ») 🎧
Maternité : Place à l’ambivalence ! (épisode « Places à prendre » avec Céline Alix et Sandra Fillaudeau) 🎧
Le suicide de l’espèce (avec Jean-David Zeitoun) 🎧
Le syndrome du wonderparent (avec Anne Peymirat) 🎧
La naissance sous toutes les coutures (avec Agnès Gepner) 🎧
Le média de la transition
* “À deux voix”, nos conversations à bâtons rompus sur l’actualité
* Des interviews de personnalités remarquables (écrivains, entrepreneurs…)
* Une vision engagée, des clefs pour aller au fond des choses
* Nos abonnés : des professionnels et citoyens engagés
* Des nouvelles de nos travaux et de nos projets
Qui nous sommes
* Laetitia | Fondatrice de CNVC Research, collabore avec Welcome to the Jungle, autrice de Du Labeur à l’ouvrage (Calmann-Lévy, 2019) et En finir avec la productivité. Critique féministe d’une notion phare de l’économie et du travail (Payot, 2022).
* Nicolas | Cofondateur de la société The Family, ancien chroniqueur à L’Obs, auteur de L’Âge de la multitude (avec Henri Verdier, Armand Colin, 2015) et Un contrat social pour l’âge entrepreneurial (Odile Jacob, 2020).
Nous sommes mariés depuis 17 ans. Après avoir vécu près de 10 ans à Londres puis à Munich, nous sommes revenus en France en août 2024. Nouveau Départ est le média que nous avons conçu ensemble au printemps 2020 pour mieux nous orienter dans l’incertitude.
Nos podcasts sont également accessibles sur Apple Podcasts et Spotify. Nouveau Départ a sa page LinkedIn et son compte Twitter : @_NouveauDepart_. Suivez-nous aussi individuellement sur LinkedIn (Laetitia & Nicolas).
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.nouveaudepart.co
Qui prend soin des travailleuses du soin ?
jeudi 4 juillet 2024 • Duration 53:37
Cette semaine, sur Nouveau Départ nous diffusons le 10ème épisode du podcast Vieilles en puissance, à l’intersection de 3 sujets : l’âge, l’argent, les femmes.
Comment ne pas être une vieille pauvre ? Et comment nous réconcilier avec les (futures) vieilles en nous mais aussi les vieilles autour de nous, les aimer, les soigner, les laisser nous soigner et nous inspirer ! Ce sont toutes ces questions qui ont déclenché notre projet de podcasts avec Caroline Taconet, Katerina Zekopoulos, et Laetitia Vitaud.
J’espère que cet épisode vous plaira !
Qui prend soin des travailleuses du soin ? Docteure en sociologie clinique et en études de genre, Rose-Myrlie Joseph, étudie le travail des femmes du soin avec une approche intersectionnelle, internationale et interdisciplinaire. Sa thèse portait sur le travail des femmes haïtiennes, plus précisément « l’articulation des rapports sociaux, de sexe, de classe et de race dans la migration et le travail des femmes haïtiennes ». Avec elle, nous regardons de plus près qui sont ces travailleuses et les vieilles en puissance qu’elles sont (ou devraient être).
Les femmes du soin sont le plus souvent invisibles. Elles s’occupent des enfants, des malades et des personnes âgées, à domicile ou dans des établissements collectifs. Ce sont essentiellement des femmes et très souvent, des femmes migrantes. Beaucoup d’entre elles sont à la tête de familles monoparentales et travaillent dans des conditions précaires.
Le sort des femmes du soin est lié à celui de tous les actifs : sans elles, de très nombreux actifs ne pourraient pas travailler. Et oui, comme on l’a “découvert” pendant les confinements, quand il n’y a plus personne pour garder les enfants, d’autres adultes ne peuvent plus faire leur travail. Nous entretenons un lien de dépendance étroit avec ces personnes. Non seulement le travail domestique et le travail de soin concerne de nombreuses femmes mais il rend possible le travail de tous les autres.
Comme l’explique Rose-Myrlie, il est important de considérer le care drain. Le concept désigne la migration des travailleuses (travailleurs) du soin (infirmières, aides-soignants, gardes d'enfants ou aides à domicile) depuis leurs pays d'origine vers des pays plus riches en quête de meilleures opportunités économiques. Dans les pays d'origine, la perte de professionnels qualifiés aggrave les pénuries de personnel de soins, dégrade la qualité et l'accessibilité des services de santé et représente une perte d'investissement pour les gouvernements qui ont financé leur formation. Les pays d'accueil, eux, bénéficient de l'arrivée de ces travailleuses, qui les aident à combler les déficits de main-d'œuvre.
Ces femmes font un travail essentiel. Mais elles sont souvent à temps partiel, avec des horaires « atypiques », peu rémunérées et peu protégées. Que leurs enfants et leurs proches soient avec elles ou dans leur pays d’origine (ou les deux), elles ont un accès limité aux bonnes écoles pour leurs enfants, aux services de soin pour elles-mêmes et leurs proches et à la protection sociale.
Qui prend soin des femmes du soin, de leur santé, de leurs enfants, de leurs aînés ? Quelle est leur vie quand elles sont vieilles ? Combien sont des « vieilles pauvres » quand elles ont l’âge de la retraite ? Comment appréhendent-elles leur propre vieillissement ?
🙏 Cet échange avec Rose-Myrlie Joseph est à écouter absolument ! Aucune réflexion sur le travail ne peut se permettre d’oublier à quel point notre société et notre économie sont dépendantes des travailleuses migrantes.
Parmi les sujets évoqués dans ce podcast :
* le travail de recherche de Rose-Myrlie ;
* l’articulation des rapports sociaux dans la migration des femmes haïtiennes ;
* le travail des haïtiennes ;
* celles qui partent et celles qui restent ;
* le fait que “la retraite, c’est les enfants” ;
* le vieillissement des femmes du soin ;
* la division sexuelle du travail et la division internationale du travail ;
* le care drain ;
* les familles des migrantes ;
* les liens de dépendance qui existent dans le monde du travail ;
* les vieilles en puissance…
Pour aller plus loin :
💡 Domesticités : Groupe de recherche interdisciplinaire sur les domesticités :
Que deviennent les enfants des travailleuses domestiques? Comment ces travailleuses de care arrivent-elles à prendre soin de leurs enfants ? Il est fondamental de se demander comment font ces cheffes de fil des familles transnationales pour “concilier” leur travail domestique et leur vie familiale.Comment se définit le projet parental pour ces femmes ? Quelle est la place du projet de mobilité sociale intergénérationelle dans ces familles où les parents, les travailleuses domestiques et de care en particulier, ont l’impression d’avoir échoué ? Comment font-elles pour réussir leurs enfants ? Entre leur projet de réussite scolaire pour leurs enfants et les contraintes de la domesticité, comment articulent-elles leurs sphères de vie? Comment concilient-elles le service domestique, le travail scolaire, et les tâches parentales plus généralement ? Comment font-elles face à l’institution (pré)scolaire, ses attentes, la coéducation?
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.nouveaudepart.co
Quel est le prix à payer du couple ?
jeudi 2 mai 2024 • Duration 01:13:12
Cette semaine, sur Nouveau Départ nous diffusons le 5ème épisode du podcast Vieilles en puissance, à l’intersection de 3 sujets : l’âge, l’argent, les femmes.
Comment ne pas être une vieille pauvre ? Et comment nous réconcilier avec les (futures) vieilles en nous mais aussi les vieilles autour de nous, les aimer, les soigner, les laisser nous soigner et nous inspirer ! Ce sont toutes ces questions qui ont déclenché notre projet de podcasts avec Caroline Taconet, Katerina Zekopoulos, et Laetitia Vitaud.
J’espère que cet épisode vous plaira !
Quel est pour les femmes le « prix à payer » du couple hétérosexuel ? C’est la question que s’est posée la journaliste et coach Lucile Quillet dans son livre Le prix à payer. Son diagnostic est sans appel : le couple hétéro coûte cher aux femmes.
Où passe l’argent des femmes, celui qu’elles ont et celui qu’elles n’auront jamais ? À force d’écrire sur la vie des femmes, leur travail, leurs enfants, leur corps, leur vie affective, leur argent depuis des années, j’ai réalisé tout ce que l’idéal du couple hétéronormé leur coûtait. Et me suis demandé : le couple est-il une arnaque ?
Dans ce livre, Lucile a fait la « grande addition » : avant, pendant et après le couple, les femmes ont plus de dépenses mais aussi plus de manque à gagner. Charges esthétique, contraceptive, sexuelle, émotionnelle… corvées domestiques, carrière freinée, etc. Tant de temps passé à des tâches altruistes, non rémunérées et non reconnues, qui finit par les appauvrir !
Bien qu’on en parle un peu plus depuis quelques années, l’argent reste encore tabou au « royaume du don de soi qu’est l’amour ». Et surtout, les calculs du couple défavorables aux femmes sont soutenus par l’État, notamment notre système fiscal.
Hommes et femmes n'ont pas été éduqués et socialisés de la même façon vis-à-vis de l'argent. Pour les premiers, il est un attribut de pouvoir viril, un pré carré masculin. c'est un outil de puissance, qui fortifie l'ego. L'imagerie de l'argent est constituée de hautes tours grises, d'hommes en cravate, de traders et politiciens sérieux. Longtemps, le salaire des femmes a été versé à leur mari ou leur famille. Elles n'ont plus ouvrir leur propre compte en banque qu'en 1965. Et n'ont été autorisées à pénétrer dans l'enceinte de la bourse de Paris qu'en 1967. En miroir, il est pour les femmes un terrain interdit. Celles qui parlent argent, pensent argent et en gagnent beaucoup sont un peu des mantes religieuses. Vénales, calculatrices, avares, suspectes, dangereuses. Elles fragilisent les hommes en mettant un pied dans leur domaine réservé. La notion d'appétit monétaire, comme sexuel ou alimentaire d'ailleurs leur est défendu. Car elles donnent la vie et sont censés ne jamais s'arrêter de donner. Clé de voûte de la cellule familiale, l'ordre social repose sur leur dévotion. Les femmes ne peuvent être égoïstes, penser à leur argent, donc à leur intérêt ou leur plaisir : c'est « anti-féminin ».
Parmi les sujets évoqués dans ce podcast :
* Les charges esthétique et contraceptive ;
* Le travail gratuit dans le couple ;
* La maternité ;
* Les dépenses du couple ;
* L’épargne et l’investissement (“Madame PQ et monsieur Voiture”) ;
* L’impact du couple sur la carrière des uns et des autres ;
* Les divorces et séparations (“lever de rideau” ou “passage à la caisse”) ;
* Les prestations sociales et leur fiscalité conjugalisées ;
* Les centaines de milliers de places en crèche qui manquent ;
* Le congé paternité…
Pour aller plus loin :
* Le prix à payer : le livre de Lucile sur ce que le couplé hétéro coûte aux femmes
* Les articles de Lucile pour Welcome to the Jungle
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.nouveaudepart.co
Après Merkel : une chancelière verte ?
mardi 27 avril 2021 • Duration 01:03:11
Notre premier podcast “À deux voix” 🎧 de la semaine est consacré à une discussion sur l’actualité politique allemande. Cette année électorale en pleine pandémie est riche en rebondissements. Et les Verts avancent leurs pions.
Le 26 septembre prochain, à l’issue des élections fédérales qui renouvellent les membres du Bundestag (Bundestagswahl), Angela Merkel laissera sa place de chancelière. C’est d’ailleurs la première fois depuis l’après-guerre qu’un chancelier au pouvoir ne fait pas campagne. En pleine pandémie, sur fond de controverses sur les incohérences de la gestion sanitaire et la lenteur de la campagne de vaccination, les batailles politiques font rage. Les campagnes politiques se poursuivent malgré tout.
Fatigués par des confinements presque ininterrompus depuis des mois et en colère contre les responsables politiques, les Allemands sont “mütend” (un mot valise qui associe les mots wütend, “en colère”, et müde, “fatigué”). On s’attend donc à des surprises lors des élections fédérales de cette année. La K-Frage (la question “Qui sera chancelier ?”) est sur toutes les lèvres.
Armin Laschet, ministre-président du Land le plus peuplé d’Allemagne (la Rhénanie-du-Nord-Westphalie), a été récemment élu à la tête de l’Union chrétienne-démocrate (la CDU) et aurait dû être le candidat “naturel” à la chancellerie pour prendre la suite de Merkel. Mais sa mauvaise gestion de la pandémie dans son Land et sa position pro-immigration ont provoqué des contestations à droite. Il en a résulté plusieurs semaines de bataille politique avec Markus Söder, ministre-président de Bavière et leader de la CSU, le parti frère de la CDU.
Pendant que la droite offre un spectacle de désunion et de chaos politique, les Verts, eux, avancent en rangs serrés. Pour la première fois de leur histoire, ils ont désigné un candidat à la chancellerie, en l’occurence, une femme, Annalena Baerbock. Autrefois, seuls les grands partis le faisaient car ils étaient mieux placés pour diriger des coalitions au parlement. Mais les sociaux-démocrates allemands ayant presque disparu du paysage politique, les Verts sont désormais la deuxième force politique du pays.
Dans ce podcast, Nicolas et moi faisons le point sur le feuilleton politique qui s’est déroulé ces dernières semaines, et revenons sur l’histoire particulière (et plutôt palpitante) des Verts allemands. La candidate des Verts pourrait-elle succéder à Merkel à la chancellerie ? Nous proposons plusieurs scénarios possibles…
La CDU et la succession d’Angela Merkel (conversation “À deux voix”)
La gauche et la droite : que signifient-elles aujourd'hui ? (conversation “À deux voix”)
30 ans d'unité allemande (conversation “À deux voix”)
Un entrepreneur français en Allemagne (conversation avec Vincent Huguet)
Les forces et faiblesses de l'Allemagne (conversation “À deux voix”)
Nos podcasts gratuits sont également accessibles sur Apple Podcasts et Spotify. Nouveau Départ a sa page LinkedIn et son compte Twitter : @_NouveauDepart_. Suivez-nous aussi individuellement sur LinkedIn (Laetitia & Nicolas) et sur Twitter (Nicolas & Laetitia).
(Générique : Franz Liszt, Angelus ! Prière Aux Anges Gardiens—extrait du disque Miroirs de Jonas Vitaud, NoMadMusic.)
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.nouveaudepart.co
Travailleurs / entreprises : la distance se creuse
jeudi 22 avril 2021 • Duration 48:07
Notre second podcast “À deux voix” 🎧 de la semaine, épisode 5 de notre projet La flamme et le vent, est consacré à l’impact de la transformation du monde du travail. Comment l’économie des foyers se recompose-t-elle dans un contexte où le lien se distend de plus en plus entre les entreprises et les individus qui travaillent pour elles ?
Les transformations du travail sont l’un des sujets que nous abordons le plus souvent dans nos podcasts Nouveau Départ. Mais nous trouvons toujours de nouveaux angles et de nouvelles interrogations pour en discuter ! Dans notre série La flamme et le vent, c’est à l’entité du foyer que nous nous intéressons en tout premier lieu.
La question que nous posons ici est la suivante : quelles sont les conséquences de la désagrégation du “contrat de labeur” dont parle Laetitia dans son livre Du labeur à l’ouvrage (Calmann-Lévy, 2019) sur le foyer en tant qu’entité ?
Alors que les protections associées à l’emploi salarié se distendent de plus en plus et que les carrières sont de moins en moins linéaires, la solidité des relations familiales et amicales et la densité de nos réseaux de relations en tout genre jouent un rôle de plus en plus critique.
La relation entre l’employeur et le travailleur était centrale dans le monde industriel, elle est désormais devenue plus fragile et moins centrale. Comme on la vu depuis le début de cette pandémie, c’est de plus en plus à l’échelle du foyer (et dans la sphère domestique) que se jouent les choses les plus importantes en matière de transformation du travail.
C’est ainsi que l’on peut analyser la Shecession (cette récession économique qui touche tout particulièrement les femmes) : faute de pouvoir faire garder leurs enfants par quelqu’un d’autre, près de 2,5 millions de mères américaines ont dû abandonner leur carrière pour s’occuper de leurs enfants.
De même, avec la banalisation du télétravail, de nombreux cadres occupés à domicile ont vu le centre de gravité de leur vie professionnelle se déplacer dans la sphère domestique. Les conjoints, enfants ou colocataires sont devenus autant de “collègues” avec lesquels interagir quotidiennement et organiser le partage de l’espace et des ressources domestiques.
Le rôle des arbitrages professionnels réalisés au sein du foyer fait pourtant rarement partie des angles d’analyse sur les transformations du travail. Le sujet de la garde d’enfants n’intéresse guère les entreprises. Les interrogations sur l’avenir de l’espace de travail se concentrent sur la question des “bureaux de demain” et comment y “faire revenir” les salariés plutôt que sur l’articulation entre tous les espaces de travail et le rôle du foyer.
* Notre nouveau projet | La flamme et le vent | Épisode 0 (conversation “À deux voix”)
* Enfance : les transitions de la famille | La flamme et le vent | Épisode 1 (conversation “À deux voix”)
* Le piège du couple à deux carrières | La flamme et le vent | Épisode 2 (conversation “À deux voix”)
* Le foyer à l’épreuve de la longévité | La flamme et le vent | Épisode 3 (conversation “À deux voix”)
* La solitude : l'autre pandémie | La flamme et le vent | Épisode 4 (conversation “À deux voix”)
* Qu'est-ce que "faire carrière" aujourd'hui ? (conversation “À deux voix”)
* Sept tendances qui révèlent le futur du travail (conversation “À deux voix”)
* L’ambition : un concept dépassé ? (conversation “À deux voix”)
Nos podcasts gratuits sont également accessibles sur Apple Podcasts et Spotify. Nouveau Départ a sa page LinkedIn et son compte Twitter : @_NouveauDepart_. Suivez-nous aussi individuellement sur LinkedIn (Laetitia & Nicolas) et sur Twitter (Nicolas & Laetitia).
(Générique : Franz Liszt, Angelus ! Prière Aux Anges Gardiens—extrait du disque Miroirs de Jonas Vitaud, NoMadMusic.)
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.nouveaudepart.co
Le consommateur, ennemi du travailleur ?
mercredi 21 avril 2021 • Duration 01:01:34
Le paradis du consommateur est-il devenu l’enfer du travailleur ? C’est la question posée par Denis Pennel dans son ouvrage Le Paradis du consommateur est devenu l’enfer du travailleur, paru tout récemment aux Éditions du Panthéon.
Dans cette interview, nous discutons des grandes transformations du travail rendues si visibles en temps de pandémie.
Denis Pennel a déjà publié plusieurs ouvrages sur les transformations du travail, parmi lesquels Travail, la soif de liberté, en 2017, dans lequel il expliquait que les start-uppers, coworkers et autres “slashers” étaient en train de réinventer le travail : “Après l’esclavage, le servage, l’artisanat et le salariat, le travail entre dans un nouvel âge,” écrivait-il alors.
Optimiste sur les évolutions en cours, il parlait alors surtout de l’émancipation des travailleurs : “le lien de subordination fait d’obéissance et de contrôles est devenu contre-productif et tend de plus en plus à être remplacé par du management collaboratif, où l’autonomie et la responsabilisation prévalent.”
Managing director de la World Employment Confederation, Denis est aux avant-postes pour observer les évolutions du monde du travail. Grand spécialiste de l’histoire de l’interim, dont il raconte la genèse dans ce podcast, il semble plus circonspect aujourd’hui sur la “libération” des travailleurs. Dans une sorte de schizophrénie croissante, les intérêts des consommateurs que nous sommes entrent en conflit avec ceux des travailleurs.
Dans son dernier livre, paru il y a quelques semaines, il se fait ainsi l’avocat d’un nouveau contrat social : “Si le futur risque bien de ressembler au passé, ce n’est pas en essayant de colmater notre sytème actuel que l’on arrivera à inventer des solutions à la hauteur des défis posés par cette nouvelle révolution industrielle.”
L’entrée dans le XXIe siècle a consacré une révolution de notre modèle économique : le passage d’une économie de masse à une économie dictée par la demande. Une soif de consommation effrénée et immédiate de produits personnalisés, fabriqués à la demande, s’est généralisée.
Une nouvelle ère où le consommateur, devenu roi, impose aux entreprises de se réorganiser pour devenir plus agiles, et ce au détriment des travailleurs. Une société de surabondance, caractérisée par le gaspillage des ressources, une hausse des inégalités, et une course folle vers le « toujours plus ».
Dans cette interview, Denis dresse le constat d’un monde du travail dicté par les exigences toujours plus grandes de la multitude de ces consommateurs qui veulent être satisfaits “ici et maintenant”, des entreprises de plus en plus fragmentées qui veulent “consommer” du travail de manière plus flexible pour faire face aux incertitudes du marché, et d’un travail qui devient plus “protéiforme et liquide”.
Il explique aussi que la crise que nous vivons actuellement a rendu plus visible le caractère insoutenable du dogme productiviste. Mais il est optimiste sur les remèdes : la nouvelle frugalité de consommateurs plus responsables, l’écologie humaine au travail, la réinvention de nos systèmes de protection sociale ne sont en rien impossibles. À nous de “réhumaniser le capitalisme” !
Nos podcasts gratuits sont également accessibles sur Apple Podcasts et Spotify. Nouveau Départ a sa page LinkedIn et son compte Twitter : @_NouveauDepart_. Suivez-nous aussi individuellement sur LinkedIn (Laetitia & Nicolas) et sur Twitter (Nicolas & Laetitia).
(Générique : Franz Liszt, Angelus ! Prière Aux Anges Gardiens—extrait du disque Miroirs de Jonas Vitaud, NoMadMusic.)
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.nouveaudepart.co
Faillites d'entreprises : une tempête à venir ?
mardi 20 avril 2021 • Duration 54:25
Notre premier podcast “À deux voix” 🎧 de la semaine est consacré à une discussion sur les faillites d’entreprises, du point de vue de la transition numérique, de l’emploi et du droit – un sujet d’actualité à bien des égards !
En 2020, grâce à des aides multiples (dispositif du chômage partiel, prêts garantis par l’État, décalages de cotisations sociales, etc.), il y a eu en France nettement moins de faillites qu’en 2019 : les défaillances d’entreprises ont reculé de 37% ! Mais quand les entreprises ne seront plus sous perfusion, combien ne seront plus en mesure de payer leurs dettes et tenir leurs engagements ?
Certains experts s’attendent à un “tsunami” de faillites cette année et l’an prochain : “le faible nombre actuel de procédures s'apparente au retrait de la mer avant l'arrivée d'un tsunami”, explique cet article de Capital. Jusqu’à 40% des bars et restaurants, par exemple, pourraient mettre la clé sous la porte. Autre exemple : dans les “écosystèmes aéroportuaires”, la déferlante de faillites et de licenciements a déjà commencé.
Depuis mars 2021, de nombreuses entreprises qui auraient fait faillite l’an dernier sans la pandémie, commencent maintenant à être en cessation de paiement. À propos de ces entreprises artificiellement mises sous perfusion par les aides d’État de la période de pandémie, on parle parfois d’entreprises “zombies”. Dans un Édito consacré à ce sujet, Nicolas avait déjà écrit il y a quelques temps :
Les économistes ont une image pour évoquer ces entreprises : ils les appellent les “entreprises zombies” 🧟♀️ Aujourd’hui, elles tiennent encore debout et poursuivent tant bien que mal leur activité ; mais en réalité, elles sont déjà mortes et cela se verra instantanément le jour où l’État cessera de les soutenir – parce qu’il n’y aura plus d’argent dans les caisses, parce que les taux d’intérêt seront repartis à la hausse, ou encore, tout simplement, parce qu’il n’est pas sain de soutenir éternellement des entreprises incapables de faire croître leur activité et de générer des bénéfices.
La situation paraît encore plus critique si l’on considère les différentes régions du monde. Les pays qui ont réussi à contenir la pandémie sont déjà engagés sur un chemin de reprise économique : c’est le cas de la Chine, foyer initial de l’épidémie, de ses principaux partenaires commerciaux en Asie, ainsi que de l’Allemagne, le bon élève en Europe. En revanche, les notes de conjoncture prédisent un nouveau ralentissement sans précédent de l’économie dans les pays qui font face à une nouvelle vague de contaminations, comme l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Brésil et le Mexique.
La faillite d’une entreprise regroupe plusieurs notions, comme celles du surendettement, de la cessation de paiements, du redressement et de la liquidation judiciaires. Pour mieux comprendre les enjeux juridiques et économiques autour du droit des faillites et des “procédures collectives”, j’interroge Nicolas sur ces concepts et les controverses autour de notre droit des faillites. Quand il était inspecteur des finances, il s’était penché de près sur ce sujet complexe…
Dans ce podcast, nous discutons aussi de la transformation de l’économie dont certaines faillites sont actuellement le reflet et du sujet de l’emploi placé au coeur de tous les débats sur la question des faillites. Nous faisons quelques comparaisons internationales pour mieux éclairer ces enjeux.
Nos podcasts gratuits sont également accessibles sur Apple Podcasts et Spotify. Nouveau Départ a sa page LinkedIn et son compte Twitter : @_NouveauDepart_. Suivez-nous aussi individuellement sur LinkedIn (Laetitia & Nicolas) et sur Twitter (Nicolas & Laetitia).
(Générique : Franz Liszt, Angelus ! Prière Aux Anges Gardiens—extrait du disque Miroirs de Jonas Vitaud, NoMadMusic.)
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.nouveaudepart.co
La solitude : l'autre pandémie
jeudi 15 avril 2021 • Duration 55:35
Notre second podcast “À deux voix” 🎧 de la semaine, épisode 4 de notre projet La flamme et le vent, est consacré à une analyse du phénomène de la solitude, une épidémie du XXIe siècle.
Que l’on parle des personnes vivant seules (dans un foyer composé d’une seule personne) ou de toutes celles qui souffrent d’un sentiment d’isolement, la solitude est un phénomène qui prend tant d’ampleur dans le monde entier que certains parlent d’une “épidémie” ou d’une “pandémie”, au même titre que le COVID-19.
Le terme est d’autant plus approprié que de nombreuses études ont montré que la solitude tue (autant que le tabagisme et l’alcoolisme). Il y a, par exemple, cette étude de Harvard menée sur huit décennies, qui a révélé à quel point le fait d’appartenir à une communauté est le facteur le plus important dans le bonheur et la longévité. (Ce TED talk de Robert Waldinger vous en offre une synthèse efficace de 12 minutes).
En France, la solitude progresse fortement. La pandémie a tristement mis en lumière la souffrance qu’elle engendrait. Dans sa dernière enquête, la Fondation de France montre que près de 15% des Français se trouvent en situation d’isolement :
L'isolement relationnel en France gagne du terrain et s’étend à toutes les catégories de population. C’est ce que révèle entre autres l'Etude sur les solitudes, menée par la Fondation de France et le Crédoc. Par exemple, si l’isolement va de pair avec la précarité, les catégories socio-professionnelles les plus aisées sont elles aussi de plus en plus touchées par ce phénomène. De même, si les personnes âgées subissent le plus fortement des situations d'isolement, les jeunes sont de moins en moins épargnés… L’étude révèle également que les femmes souffrent davantage que les hommes de solitude. Autre constat : celui de l’impact de la crise sanitaire actuelle. La forte hausse du chômage déjà amorcée et la corrélation établie entre précarité, chômage et isolement pointe un risque majeur d’une augmentation prochaine de l’isolement relationnel.
De plus en plus, la solitude frappe toutes les classes d’âge, y compris les jeunes. On a beaucoup parlé de la solitude des étudiants en période de pandémie. Confinés devant leurs ordinateurs, ceux/celles qui n’ont pas (encore) développé de relations sociales, amicales, amoureuses et professionnelles, vivent la solitude de manière dramatique.
À certains égards, la montée de la solitude est l’un des grands symptômes de la transition économique et sociale que nous vivons. C’est ce qu’explique l’économiste britannique Noreena Hertz, dont l’ouvrage The Lonely Century: Coming Together in a World that’s Pulling Apart, fait beaucoup parler de lui dans les médias anglo-saxons ces temps-ci (le livre est sorti fin 2020) :
Influencée par la mondialisation, l'urbanisation, les inégalités croissantes et les asymétries de pouvoir, par l'évolution démographique, la mobilité, les bouleversements technologiques, l'austérité, et maintenant aussi par le coronavirus, je crois que la manifestation contemporaine de la solitude va au-delà de notre désir ardent de connexion avec ceux qui nous entourent physiquement, de notre besoin d'aimer et d'être aimé, et de la tristesse que nous ressentons lorsque nous nous considérons privés d'amis. Elle englobe également le fait que nous nous sentons déconnectés des politiciens et de la politique, que nous nous sentons coupés de notre travail et de notre lieu de travail, que beaucoup d'entre nous se sentent exclus des acquis de la société, et que tant d'entre nous se croient impuissants, invisibles et sans voix.
Laetitia et moi discutons des enseignements que l’on peut tirer de la société japonaise où la solitude est si criante que l’on a récemment créé un ministère de la solitude, ainsi que d’une manifestation physique de cette deuxième pandémie : la “crise du toucher”.
* Notre nouveau projet | La flamme et le vent | Épisode 0 (conversation “À deux voix”)
* Enfance : les transitions de la famille | La flamme et le vent | Épisode 1 (conversation “À deux voix”)
* Le piège du couple à deux carrières | La flamme et le vent | Épisode 2 (conversation “À deux voix”)
* Le foyer à l’épreuve de la longévité | La flamme et le vent | Épisode 3 (conversation “À deux voix”)
* Logement : tout ce qui change avec la pandémie (conversation “À deux voix”)
* Pandémie et démographie (conversation “À deux voix”)
Nos podcasts gratuits sont également accessibles sur Apple Podcasts et Spotify. Nouveau Départ a sa page LinkedIn et son compte Twitter : @_NouveauDepart_. Suivez-nous aussi individuellement sur LinkedIn (Laetitia & Nicolas) et sur Twitter (Nicolas & Laetitia).
(Générique : Franz Liszt, Angelus ! Prière Aux Anges Gardiens—extrait du disque Miroirs de Jonas Vitaud, NoMadMusic.)
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.nouveaudepart.co
Rendre le monde plus accessible
mercredi 14 avril 2021 • Duration 38:10
Voici, dans cette édition de Nouveau Départ, ma conversation avec Olivier Jeannel, fondateur et dirigeant de Rogervoice, une entreprise du portefeuille de The Family qui sous-titre les conversations pour les personnes sourdes et malentendantes… et rend ainsi le monde plus accessible pour tous.
Bonne écoute (ou bonne lecture ci-dessous 👇) !
Bonjour à tous. Je suis Nicolas Colin, cofondateur avec Laetitia Vitaud de Nouveau Départ, le média de la crise et de la transition. Aujourd’hui, je reçois en interview Olivier Jeannel, le fondateur et dirigeant de Rogervoice, entreprise qui développe une application pour sous-titrer les appels téléphoniques à l’attention des personnes sourdes et malentendantes – mais aussi, potentiellement, de tout un chacun ! Bonjour Olivier, bienvenue sur Nouveau Départ !
Bonjour Nicolas !
Merci beaucoup Olivier de m’accorder un peu de ton temps. Je vais commencer par la première question rituelle qu'on pose à tous nos invités : comment s'est passée pour toi cette année de pandémie ? Pour toi et pour Rogervoice, bien sûr ! Quel a été l'impact de tout ça sur ton quotidien?
Eh bien écoute, tout ça nous a pris de court, comme tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 16 mars, date anniversaire du confinement en France [et de l’enregistrement de ce podcast]. Et il y a un an, nous avons senti la vague venir : en 48 heures, il nous a fallu migrer totalement en télétravail. Nous le pratiquions déjà à petite dose, donc c'est une transition qui a été plus facile à gérer que pour d'autres entreprises. Mais ç'a néanmoins été un ajustement pour nous et pour beaucoup de nos clients et utilisateurs, qu'il nous a fallu suivre !
Ensuite, nous nous sommes sentis portés par cette vague de la migration vers le télétravail. Il faut dire que les télécommunications ont été l’un des grands bénéficiaires de cette pandémie, disons-le comme ça. Les mesures de confinement qui ont été imposées ont obligé les uns et les autres à communiquer de plus en plus à distance, ce qui est l’objet même des télécommunications.
On va parler de tout ça plus en détail, bien sûr, mais avant ça raconte-moi un peu ton parcours. Que faisais-tu avant la création de Rogervoice il y a 7 ans ?
À l’époque, je travaillais chez Orange et un cousin m’avait mis en relation avec Oussama [Ammar, cofondateur de The Family]. J’ai fini par le rencontrer et, quand je lui ai expliqué mon idée, il m’a dit “Tu es fou, mais je vais t’aider”. A cette époque, j’ai notamment réalisé que grâce au système des allocations chômage il m’était possible de quitter mon emploi et de recevoir des allocations pendant presque deux ans. Incroyable, comme opportunité !
J’étais donc chez Orange, j’explorais cette idée depuis un moment, sous-titrer les appels téléphoniques. Le sujet n’était pas si nouveau : de nombreuses initiatives existaient déjà. Mais une chose a changé la donne : l’émergence des smartphones et des fonctionnalités de reconnaissance vocale dont la plupart d’entre eux sont équipés.
2011, en particulier, c’est l’année du lancement de Siri. Au début, on s’est beaucoup moqué de ces fonctionnalités encore rudimentaires, mais aujourd’hui c’est devenu bluffant ! Mais pour moi, c’était déjà une source d’inspiration : ma vision était qu’on puisse communiquer sans se heurter aux frontières ni à la barrière de la langue, tout cela grâce à une application accessible à moindre coût. L’enjeu me semblait énorme du point de vue de l’accessibilité. Les outils de reconnaissance vocale étaient encore loin d’être parfaits à l’époque, mais il fallait bien commencer quelque part. Et aujourd’hui, les progrès accomplis sont impressionnants.
Que faisais-tu exactement chez Orange ? Étais-tu ingénieur, côté infrastructure, ou plutôt focalisé sur les usages et la commercialisation des produits ?
Chez Orange, j’ai d’abord travaillé à la direction financière, puis j’ai été parachuté en Espagne, à Madrid, pendant deux ans. J’ai ensuite passé quatre ans à la direction des contenus, où je m’occupais de bâtir des plans d’affaires. J’étais spécialisé dans la planification et cela m’a permis d’améliorer ma connaissance du marché des télécoms et des modèles d’affaires qui existent dans le champ des médias.
C’est donc là que tu as cette idée de sous-titrer les appels téléphoniques. Tu vois émerger ces nouvelles briques technologiques – la reconnaissance vocale, les smartphones que tout le monde emmène dans sa poche en permanence. Et grâce à tout cela, des nouvelles applications deviennent possibles.
Peux-tu nous raconter ces anecdotes stupéfiantes dont tu te sers pour illustrer la finalité de Rogervoice ? Nous autres qui entendons (à peu près) bien, nous ne mesurons pas à quel point le téléphone, cet outil inventé pour faciliter la communication, peut devenir une barrière pour les personnes sourdes et malentendantes ! Raconte-nous les problèmes concrets que permet de résoudre la reconnaissance vocale et le fait de sous-titrer les communications téléphoniques.
Eh bien, nous en faisons justement l’expérience avec cette conversation : ce que tu dis est sous-titré pour moi grâce à Rogervoice, et je peux ainsi répondre à tes questions ! Tout cela c’est assez nouveau – ce n’était pas du tout évident à l’époque où j’ai lancé Rogervoice. Et c’était très loin d’être une priorité pour la plupart de mes interlocuteurs chez Orange.
Mais je ne me suis pas laissé décourager. J’en ai beaucoup parlé autour de moi. Lors d’une soirée de fin d’année, je me suis permis d’aborder le directeur technique d’Orange, qui se trouvait là, et de lui parler brièvement de mon projet. Il m’a demandé de venir le voir et de lui parler des détails et la semaine d’après, j’étais dans son bureau. Ensuite, je me suis rendu dans les locaux de Orange Valley.
Tout est ensuite allé très, très vite. Les gens se sont emballés. Bien sûr c’était compliqué de faire démarrer la machine, de trouver des soutiens, de créer une unité, d’allouer un budget. J’ai fini par me heurter à des difficultés, par manquer d’encouragements, et cela m’a conduit à quitter Orange pour monter Rogervoice.
Et pour revenir à ta question, c’est vrai que les personnes sourdes et malentendantes ont les plus grandes difficultés à communiquer dès lors que cela passe par le téléphone. C’est quelque chose que j’ai moi-même beaucoup éprouvé au quotidien. On ne peut tout simplement pas se passer du téléphone aujourd’hui, c’est une réalité.
Par exemple, les services après-vente des grandes entreprises comme EDF ou Darty font tout pour empêcher les clients d’accéder à leur centre d’appel : il faut parfois cinq à dix clics avant d’avoir un interlocuteur au bout du fil ! Mais, malgré ces efforts pour dissuader l’usage du téléphone, ce centre d’appel existe toujours et il est souvent la seule façon de résoudre certains problèmes ou d’accéder à certaines informations.
Lorsque les gens finissent par trouver le numéro, ils franchissent une étape importante : avoir un interlocuteur au bout du fil permet de résoudre des problèmes très particuliers ou d’avoir des réponses à des questions compliquées. Les entreprises essaient de donner un maximum d’information en ligne pour éviter la saturation des centres d’appels, mais nombreux sont les cas où il faut avoir quelqu’un au bout du fil.
La même chose existe dans la vie de tous les jours. Appeler ses proches, joindre la crèche parce que son enfant est malade : tout cela se passe par téléphone. Or tout un pan de la population a des difficultés à utiliser ce moyen de communication : c’est le cas des personnes âgées qui entendent moins bien et doivent s’équiper d’appareils auditifs ; c’est le cas des personnes plus jeunes nées avec une surdité profonde ou qui ont été victimes d’accidents de la vie ou de maladies. On parle, rien qu’en France, de 500 000 personnes qui ne peuvent pas téléphoner au quotidien du fait de leur surdité !
Qu’a-t-on fait pour cette population laissée pour compte ? Jusqu’à présent, pas grand chose. Mais récemment, on a enfin sauté le pas.
On a parlé du smartphone, on a parlé des logiciels de reconnaissance vocale. Dis-nous-en un plus sur Rogervoice par rapport à tout ça : c’est une sorte de couche applicative qui utilise des briques technologiques développées par d’autres, notamment Apple, c’est bien ça ?
C’est bien cela. Il y a à la fois une activité d’opérateur télécom, qui consiste à assurer la communication entre deux personnes, et la mise au point d’une interface pour rendre cette communication accessible pour les personnes sourdes et malentendantes. Au début, on a externalisé beaucoup de choses pour pouvoir se concentrer sur l’essentiel en interne. Nous recourons à des technologies de téléphonie comparable à celles utilisées pour les visioconférences. Et il y a aussi des technologies de traitement, par exemple pour réduire les délais de transmission.
Tout cela se fait dans un contexte de progrès technologique continu. Par exemple, on fait sans cesse des progrès en matière de sous-titrage, donc la barrière descend et nous devons rester compétitifs. Du coup, pour moi, l’objectif n’est pas d’avoir les meilleurs sous-titres possibles. L’objectif c’est plutôt que la transformation de la voix en sous-titres soit fluide et fasse l’objet d’une ergonomie irréprochable.
En effet, et la raison c’est qu’on parle de conversations téléphoniques – c’est-à-dire vraiment une partie de notre vie quotidienne, quelque chose qu’on fait habituellement et sans vraiment réfléchir, pour un besoin souvent immédiat. La plupart des coups de fil ne durent que quelques minutes, par exemple, comme tu l’as dit, pour informer la crèche que son enfant est malade. Dans ces conditions, il faut que l’expérience utilisateur soit simple et fluide, ne pas avoir à passer par quinze étapes successives ou à connecter différents appareils entre eux pour transmettre une information aussi rudimentaire.
Par ailleurs, puisqu’il s’agit de conversations téléphoniques, si je ne me trompe pas la barre est moins haute que pour des retranscriptions de texte par exemple. Laetitia et moi avons été confrontés à ça avec Nouveau Départ : transcrire une interview en anglais à l’aide d’un logiciel, corriger la transcription, puis la traduire en français à l’aide d’un autre logiciel, puis ensuite corriger à nouveau la traduction pour que ça soit lisible. Là, dans le cas de Rogervoice, on parle de conversations beaucoup plus triviales – encore une fois, des propos qu’on s’échange au téléphone, des informations qu’on transmet à divers interlocuteurs,, des instructions qu’on donne à des collaborateurs.
Dans tous ces cas, on n’a pas besoin d’une grammaire parfaite ou d’une orthographe irréprochable. Du coup, comme tu le dis, la barre n’est pas si haute en matière de génération de sous-titres et l’enjeu est ailleurs : l’optimisation de tout ce flux de traitement, de la captation de la voix jusqu’à la génération des sous-titres dans une interface facile à utiliser. Et Rogervoice a beaucoup avancé sur ce front depuis 7 ans. Tu me disais que tu internalises de plus en plus, dis-nous en peu plus !
Oui, Rogervoice emploie aujourd’hui 46 salariés avec des profils très variés.
Nous employons plusieurs interprètes en langue des signes pour pouvoir proposer des services de traduction en langue des signes à des clients. Nous proposons aussi des services de correction de sous-titrage en temps réel pour des applications plus exigeantes que les conversations du quotidien. Et, bien sûr, nous employons des développeurs informatiques ainsi qu’un directeur produit et une graphiste chargée de notre identité visuelle sur tous nos supports de communication, mais aussi du design de notre application.
Encore une fois, nous accordons beaucoup d’importance à l’ergonomie !
Je me souviens de nos premières conversations sur Rogervoice. Tu m’expliquais ta dépendance à l'époque à certaines décisions de l'État qui n'étaient pas encore prises en matière d'accessibilité. Le législateur avait imposé l'accès universel aux services publics, y compris pour les personnes sourdes et malentendantes et d’une manière plus générale les personnes en situation de handicap. Mais ensuite, il fallait déterminer les modalités techniques de cet accès et il y avait des batailles en coulisse entre différents acteurs, dont certains promouvaient des solutions un peu hors d'âge : des immenses centres d'appels très coûteux employant des agents pour faire de la traduction simultanée.
Suivant cette approche, il ne s’agissait pas d’utiliser des technologies numériques mais d’employer des personnes chargées d’écouter et de retranscrire des conversations. Le problème dans tout ça c’est que ça allait forcément coûter très cher, ça allait donc être rationné et il deviendrait tôt ou tard impossible de garantir un accès effectif aux personnes sourdes et malentendantes – par opposition à un recours aux outils de reconnaissance vocale et de sous-titrage automatique, qui permettent de servir un beaucoup plus grand nombre d’usagers à un coût plus abordable et une meilleure qualité.
Comment s’est dénouée cette histoire ? Comment Rogervoice a-t-elle tiré son épingle du jeu ?
En effet, ta mémoire ne te trompe pas, c’est comme cela que les choses se passaient à l’époque. L’accessibilité des services publics était loin d’être une priorité pour les pouvoirs publics à l’époque. Puis, ils ont fini par reconnaître son importance, mais sans opter pour l’approche optimale rendue possible par les technologies numériques. La leçon de tout ça, c’est qu’il faut absolument le concours du secteur privé pour “forcer” le recours aux meilleures technologies du moment.
Ensuite, tout s’est enchaîné très vite, avec différentes catégories d’acteurs qui ont commencé à se soucier de l’accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes – et aussi différentes approches du point de vue des interfaces et des technologies utilisées. Il y avait un appel d’offres des administrations publiques, qui voulaient mettre en place des centres d’appel dédiés. Il y avait plusieurs grandes entreprises qui cherchaient des solutions pour pouvoir rendre leurs centres d’appel accessibles pour les personnes sourdes. Et puis il y avait les opérateurs de télécommunications, sur lesquels j’ai choisi de me concentrer. Et ce sont eux, à l’époque, qui ont fait le pari audacieux de faire confiance à Rogervoice et ont permis de donner corps à cette vision : rendre la téléphonie accessible même pour ceux qui entendent mal.
Au début, ç’a été dur. Il y a eu beaucoup de critiques et de défiance de la part d’interlocuteurs qui ne comprenaient pas encore très bien les technologies disponibles à l’époque et ne comprenaient pas pourquoi les opérateurs de télécommunications faisaient le choix de se lancer avec Rogervoice. C’était courageux de leur part, et aujourd’hui, ils ne regrettent pas ce choix ! Le taux de satisfaction de leurs clients sourds et malentendants est très élevé et les utilisateurs plébiscitent notre solution. C’a été un moment difficile, on va dire ça comme ça, mais la suite des événements nous a donné raison.
Tu parles alternativement de clients et d’utilisateurs. Explique-nous les différents interlocuteurs auxquels tu as affaire dans ton métier et comment s’organisent les flux financiers autour de Rogervoice. Il y a des organisations, tes clients, qui te paient car ils veulent rendre Rogervoice accessibles à certaines personnes. Et puis il y a des individus, des utilisateurs, qui peuvent télécharger eux-mêmes l’application pour leur usage personnel et privé. Comment tout ça se passe ? Comment les gens viennent à Rogervoice ? Et que peuvent-ils t’acheter ?
Justement, cette semaine j’ai lu un article que tu as écrit sur le sujet ! Il faut dire qu’il y a une vraie différence entre les clients et les utilisateurs, et Rogervoice se retrouve exactement entre les deux, dans une position parfois un peu délicate. D’un côté, mes clients, ce sont des opérateurs de télécommunications ou des grandes entreprises, qui nous demandent parfois d’adapter nos produits pour des besoins particuliers. Nous nous concentrons beaucoup sur ce versant de notre modèle car ce sont ces clients qui génèrent la majorité de notre chiffre d’affaires et nous exposent à un très grand nombre d’utilisateurs qui utilisent Rogervoice au quotidien. C’est ce qu’on appelle le modèle B2B.
Et puis il y a également, sur l’autre versant, un modèle B2C. Tout un chacun peut télécharger l’application Rogervoice sur son téléphone, qu’il soit en Afrique du Sud ou en Pologne ou ailleurs. On peut ensuite acheter des crédits pour des minutes de conversation sous-titrée, comme sur Skype par exemple. Ce modèle fonctionne très bien à l’international.
Côté B2B, nous comptons comme clients des grandes entreprises comme la SNCF, Allianz, GRDF, Aviva – ce qu’on appelle nos grands comptes – ainsi que des opérateurs de téléphonie. Même si ce sont des grands comptes, on essaie de standardiser le produit au maximum, pour éviter d’avoir à adapter le modèle économique aux besoins particuliers de chaque client.
Quant aux utilisateurs dans le modèle B2C, ce sont eux qui viennent à toi directement, c’est bien ça ? Ils achètent des crédits et ils disposent d’un numéro de téléphone qui leur permet de joindre ou d’être joint par n’importe qui, quel que soit l’opérateur qui sert la personne au bout du fil. La seule différence, c’est que pour ces utilisateurs la conversation ne va pas avoir lieu via l’interface standard du téléphone, mais via l’application Rogervoice, de façon à bénéficier du sous-titrage.
C’est bien ça, oui. N’importe qui peut télécharger l’application et se voir attribuer un numéro de téléphone ou bien continuer d’utiliser celui qu’il a déjà. C’est un peu comme les numéros de téléphone mobile : on peut garder son numéro même lorsqu’on change d’opérateur.
Au passage, la loi oblige les opérateurs à offrir à leurs clients sourds ou malentendants une heure d’utilisation du service de sous-titrage par mois à titre gratuit. Il est prévu que ce quota augmente dans les prochaines années : 3 heures par mois en octobre 2021, puis 5 heures par mois en 2026.
Donc, oui, n’importe qui peut télécharger l’application et disposer d’un numéro de téléphone, mais les clients des opérateurs partenaires soumis à cette obligation légale bénéficient d’heures de sous-titrage gratuits financées directement par les opérateurs.
Et quand tu parles de tes clients, par exemple quand tu expliques que Rogervoice travaille avec la SNCF, qu’est-ce que la SNCF t’achète exactement ? La possibilité pour les personnes sourdes et malentendantes d’appeler le centre d’appel de la SNCF malgré leur surdité et d’avoir accès au service de sous-titrage grâce à Rogervoice ?
C’est ça, absolument ! Nous proposons notre produit via la SNCF et nous permettons à tout un chacun d’appeler à travers le centre d’appel de la SNCF à travers l’application, c’est alors la SNCF qui couvre le coût de l’appel – lequel est soit sous-titré, soit réalisé en visioconférence avec une interprète en langue des signes [pour les personnes sourdes qui ne peuvent s’exprimer qu’avec des gestes].
Dirais-tu qu’aujourd’hui les obstacles à l’adoption d’une application comme Rogervoice ont été levés ? A mes yeux, tout ça semble être une réussite en termes de politique industrielle : on a identifié que de nouvelles solutions étaient possibles, on a mis en place un régime réglementaire favorable à l’adoption de ces nouvelles solutions par les entreprises qui opèrent des centres d’appel. Est-ce que cela se traduit pour toi par plus de concurrence ? Est-ce que le marché du sous-titrage attire plein de nouveaux entrants, des nouvelles startups créées sur le même créneau que Rogervoice ?
Oui, en effet, ce marché devient très concurrentiel – pas toujours les concurrents auxquels on pense d’ailleurs ! Il y a certaines entreprises focalisées sur l’accessibilité, mais il y a aussi des concurrents indirects. Par exemple, Google propose maintenant un service de sous-titrage encapsulé dans Google Meet et le met à disposition gratuitement. Ca veut dire que cette brique technologique est de plus en plus facile à intégrer et que le sous-titrage se démocratise à toute vitesse.
Je prends ça comme une bonne nouvelle. Après tout, à l’origine, ma principale difficulté c’était de faire prendre conscience au plus grand nombre que de nouveaux modes de communication sont possibles. Personne ne s’étonne de voir des sous-titres à la télévision, mais jusqu’à une date récente personne n’avait conscience qu’on pouvait aussi sous-titrer des conversations téléphoniques en temps réel.
Il faut donc communiquer sur tout cela. Est-ce à l’administration de le faire ? Au secteur privé ? En réalité, ce qui marche, c’est la combinaison des deux. A partir du moment où des grandes entreprises proposent ce service, ça permet à des entreprises spécialisées, comme Rogervoice, de se démarquer.
Comme tu l’expliquais au début de notre conversation, il s’agit de rendre un service essentiel accessible pour plus de 500 000 personnes en France ! C’est donc très loin d’être marginal, même si beaucoup de gens ne se sentent pas concernés ou n’ont pas conscience des difficultés que rencontrent les personnes sourdes et malentendantes dans l’usage de la téléphonie.
A ce sujet, j’ai l’impression, si on revient sur cette année de pandémie et de confinement qu’on vient de passer, que l’année 2020 a permis de débloquer un peu les choses. Ca crée des opportunités d’inclusion pour les personnes sourdes et malentendantes dans un univers professionnel qui se numérise à toute vitesse grâce au travail à distance. On s’habitue à communiquer par l’entremise d’outils tels que Google Meet et Rogervoice, que toi et moi utilisons d’ailleurs pour notre conversation aujourd’hui : les questions que je te pose sont sous-titrées pour toi !
Y a-t-il, dans ce contexte, des opportunités nées du travail à distance ? On a beaucoup tendance à caricaturer le fait de travailler depuis chez soi, on dit que ça abîme les liens sociaux dans l’entreprise. En même temps, cela représente aussi une extraordinaire opportunité d’inclure tous ces gens qui ne trouvent pas leur place dans l’environnement de travail traditionnel. Grâce au travail à distance et aux outils qui le rendent possible, y compris le sous-titrage, les personnes sourdes et malentendantes peuvent plus facilement s’intégrer à leur équipe, contribuer à l’accomplissement de certaines tâches, faire valoir leurs compétences. Y a-t-il des tendances qui suggèrent que tout ça va se banaliser ? Qu’il sera normal, demain, d’échanger avec ses collègues par le biais de conversations sous-titrées ?
Effectivement, le confinement a bousculé les choses. Avant, beaucoup de choses se passaient obligatoirement en présentiel. Par exemple, pour discuter avec son banquier, il fallait aller le voir dans son bureau. Aujourd’hui, les mêmes conversations ont lieu à distance. Ca érige certaines barrières, mais ça en fait aussi tomber d’autres. Pour certaines personnes, c’est libérateur de ne pas avoir à interagir directement et de pouvoir le faire par l’entremise d’outils qui leur rendent la conversation accessible !
Si on reprend l’exemple du banquier, ça lui complique la vie qu’une personne sourde aille le voir à son bureau car il est peu probable que ce banquier maîtrise la langue des signes. Maintenant, je peux simplement lui passer un coup de fil sous-titré grâce au forfait gratuit offert par mon opérateur ou par la banque elle-même. Je redeviens maître de mes échanges avec des interlocuteurs aussi cruciaux que mon banquier, mes collègues ou d’autres personnes.
Oui, tout devient ainsi plus facile ! A ce sujet, peut-on imaginer une sorte de séquence en deux temps où, dans un premier temps, le fait d’être à distance du fait du COVID-19 nous habitue à utiliser ces outils et, dans un second temps, quand on sera à nouveau en présence les uns des autres, il deviendra banal d’utiliser ces mêmes outils quand ils contribuent à faciliter la conversation.
C’est un peu comme quand on voyage en Chine, par exemple : les serveurs dans les restaurants sont désormais habitués à prendre les commandes des Occidentaux à l’aide des outils de traduction simultanée installés sur leurs smartphones parce qu’il y a une impossibilité totale de se comprendre sans ces outils – entre les uns qui parlent mandarin et les autres qui parlent anglais ou français. Donc la banalisation de ces outils change complètement les mœurs. A l’inverse, on est encore loin du compte en France. Si on reprend l’exemple du rendez-vous à la banque, on est en présence de deux personnes francophones, mais qui ne peuvent pas se comprendre car seulement l’une d’entre elles maîtrise la langue des signes !
A ce sujet, il y a quelques années j’avais partagé avec toi cette citation trouvée dans un livre écrit par Frank Moss, ancien directeur du Medialab du MIT. Il citait l’un de ses anciens collègues du Medialab, aujourd’hui décédé, qui s’appelait Seymour Papert – l’inventeur du langage de programmation Logo, que les gens de ma génération connaissent pour l’avoir utilisé à l’école dans les années 1980.
Et donc ce Monsieur, Seymour Papert, était passionné par l’innovation au service des personnes en situation de handicap. Et beaucoup de gens qui visitaient le Medialab faisaient des objections en disant “Certes, c’est important d’aider ces personnes à accéder à certaines ressources, à certains services, mais enfin ça ne concerne pas la majorité de la population. Que faites-vous pour les autres ?”. A cela, Papert répondait la chose suivante : “Nous sommes tous en situation de handicap, c’est juste que certains le sont un peu moins que d’autres” ! Et donc, si on innove pour ceux qui sont confrontés aux situations de handicap les plus dures, cette innovation finira par profiter à tous.
Est-ce que tu observes cette dynamique à l’oeuvre s’agissant des personnes sourdes et malentendantes ? Y a-t-il, dans cet univers où se développe Rogervoice, des innovations qui naissent et vont radicalement changer les choses dans nos usages, même si certains sont un peu moins sourds que d’autres ?
Absolument ! Déjà, pour prendre les télécommunications en exemple, les SMS ont été un outil d’abord marginal qui a très vite été adopté massivement par les personnes sourdes et malentendantes, avant d’être adopté par toute la population. C’est un premier exemple assez pertinent. La même chose s’est passée avec les services de transcription écrite et de prise de notes.
Le fait de retranscrire ce qui se dit au téléphone a pour objectif de filtrer et traiter les informations pour les besoins particuliers de certaines personnes. Par exemple, à la télévision, les sous-titres soi-disant faits pour les personnes sourdes et malentendantes vont être utilisés par des personnes étrangères qui ne comprennent pas bien la langue ou bien par une personne qui veut regarder une série en silence pendant que son conjoint dort à ses côtés. On a là l’exemple d’un usage adopté bien au-delà de la population des personnes sourdes et malentendantes.
Exactement, ça illustre très bien l’idée de Seymour Papert ! Nous sommes tous sourds ou malentendants – soit tout le temps, soit seulement dans certains contextes et à des degrés variables. Et donc, toutes les innovations comme Rogervoice finiront par nous profiter à tous :-)
Dernière question avant de conclure : où en est Rogervoice aujourd’hui ? Quels sont tes plans pour les années qui viennent ? Diversifier les produits que tu vends ? Développer ton activité dans d’autres pays que la France ? Comment vois-tu les choses ?
Pour moi, dans les années qui viennent le sujet principal sera de faire en sorte que cette prise de conscience soit généralisée, qu’on ne s’étonne plus qu’il faille sous-titrer les conversations téléphoniques pour les personnes sourdes et malentendantes – qu’on ne se rappelle même plus que la question est longtemps restée sans réponse !
Il s’agit d’un choix de société : cesser de considérer que les personnes en situation de handicap ne puissent être considérées qu’en dernier recours. Les choses sont en train de changer et j’espère avoir contribué à ça. Bientôt, les bénéfices de tout cela vont devenir visibles bien au-delà des personnes sourdes et malentendantes, grâce à la baisse des prix par exemple. On ne dira plus que c’est caritatif, que le retour sur investissement est faible voire nul. Au contraire, on fera valoir que ça change les choses dans la vie quotidienne et que ces innovations de niche finissent par nous bénéficier à tous.
Merci beaucoup Olivier. En conclusion, où les gens peuvent-ils en apprendre davantage sur Rogervoice ? Et sur tous ces sujets en général, y a-t-il des auteurs de référence ? Des blogs de référence ?
Eh bien, pour les gens qui s’intéressent tout particulièrement à ces questions, je les encourage à suivre ce qui se fait dans le cadre de groupes de travail, par exemple dans le cadre de l’Union européenne. Ils peuvent aussi venir me voir : ma porte est toujours ouverte et je serais très heureux d’en discuter plus avant.
Merci encore Olivier d’avoir partagé tout ça avec nous. Très bon courage à toi pour la suite et pour le développement de Rogervoice ! A bientôt.
Merci beaucoup à toi ! Salut Nicolas.
Nos podcasts gratuits sont également accessibles sur Apple Podcasts et Spotify. Nouveau Départ a sa page LinkedIn et son compte Twitter : @_NouveauDepart_. Suivez-nous aussi individuellement sur LinkedIn (Laetitia & Nicolas) et sur Twitter (Nicolas & Laetitia).
(Générique : Franz Liszt, Angelus ! Prière Aux Anges Gardiens—extrait du disque Miroirs de Jonas Vitaud, NoMadMusic.)
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.nouveaudepart.co
Suppression de l'ENA : une mesure populiste ?
mardi 13 avril 2021 • Duration 01:02:30
Notre premier podcast “À deux voix” 🎧 de la semaine, après notre pause pascale, est consacré à une discussion sur la suppression de l’ENA.
Emmanuel Macron l’a annoncé il y a quelques jours : la haute fonction publique sera “réformée”, et l’École nationale d’administration sera remplacée par un nouvel Institut du service public (ISP). Le principe du classement de sortie sera maintenu, mais la titularisation vers les grands corps ne pourra plus se faire à la fin de la formation initiale. S’agit-il seulement d’un geste symbolique pour apaiser le ressentiment anti-élitiste des gilets jaunes ? Ou bien la réforme cible-t-elle les problèmes réels liés au recrutement et à la formation des élites de l’administration d’État ?
Cela fait des décennies que l’on critique l’ENA, cette école qui forme et recrute une partie de nos hauts fonctionnaires français. On accuse l’école d’être trop élitiste : elle représenterait un monde de l’entre-soi et de l’homogénéité sociale. On la dit trop déconnectée des réalités de l’économie d’aujourd’hui : elle ne formerait que des technocrates “moulés” pour une économie de masse fordiste qui n’existe plus.
Mais la critique de l’ENA est (presque) aussi ancienne que l’école elle-même. Créée après la Seconde guerre mondiale par le Général de Gaulle et Michel Debré pour doter la France d’une nouvelle élite de “mandarins” à même d’aider la France à relever les défis de la reconstruction de l’après-guerre, l’ENA a aussi représenté un moyen de rendre plus méritocratique (et transparent) l’accès aux plus hauts postes de la fonction publique. Avant la création de l’école, le népotisme de chaque institution était assumé.
Comment la seule suppression de cette institution pourrait-elle régler le problème du déterminisme social à l'œuvre dans le système scolaire français ? Depuis deux décennies, le classement PISA révèle que notre système scolaire devient de plus en plus inégalitaire socialement. La simple suppression m’a fait penser au proverbe : “Quand le sage montre la Lune, l’idiot regarde le doigt”. Ou encore à cette expression anglaise “Shoot the messenger” (“Tuer le messager”) qui se réfère à cette tentation que nous avons de nous débarrasser du porteur de la mauvaise nouvelle plutôt que de nous attaquer à la nouvelle elle-même.
Nicolas fait partie de la première promotion de l’ENA entièrement délocalisée à Strasbourg (la promotion 2006). Il connaît bien les débats sur sa suppression, l’histoire de l’institution et de ses réformes successives. Dans ce podcast, il fait même une petite histoire de la critique de l’ENA, dont Jean-Pierre Chevènement a été l’une des figures de proue. (Depuis que nous avons enregistré ce podcast, des journalistes ont eu l’idée de recueillir les réactions de ce critique de l’ENA à l’annonce de la réforme de Macron. Chevènement a répondu : “C'est comme si le Pape avait proposé la dissolution de la curie romaine !”)
Dans notre conversation “A deux voix”, nous discutons avec passion de toutes les controverses qui entourent cette annonce, de l’histoire de l’ENA, de son fonctionnement, des réformes successives que l’école a connues, du vécu de Nicolas à l’école, des débats sur la méritocratie, et de beaucoup d’autres choses encore.
J’ai hâte de lire vos réactions !
* Ces 20% de diplômés qui se détachent (ma conversation avec Jean-Laurent Cassely)
* L'ambition : un concept dépassé ? (conversation “À deux voix”)
* Mettons du design dans nos services publics (mon Édito à l’occasion de mon interview de Hilary Cottam)
* Pour en finir avec l'opposition public/privé (conversation “À deux voix”)
* Qu'est-ce que "faire carrière" aujourd'hui ? (conversation “À deux voix”)
* Innover dans les services publics (Édito de Nicolas et conversation avec Sébastien Soriano)
* Jean Castex et la sociologie des élites (conversation “À deux voix”)
Nos podcasts gratuits sont également accessibles sur Apple Podcasts et Spotify. Nouveau Départ a sa page LinkedIn et son compte Twitter : @_NouveauDepart_. Suivez-nous aussi individuellement sur LinkedIn (Laetitia & Nicolas) et sur Twitter (Nicolas & Laetitia).
(Générique : Franz Liszt, Angelus ! Prière Aux Anges Gardiens—extrait du disque Miroirs de Jonas Vitaud, NoMadMusic.)
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.nouveaudepart.co