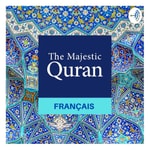Le monde en questions – Details, episodes & analysis
Podcast details
Technical and general information from the podcast's RSS feed.

Le monde en questions
Isabelle Kortian
Frequency: 1 episode/11d. Total Eps: 150
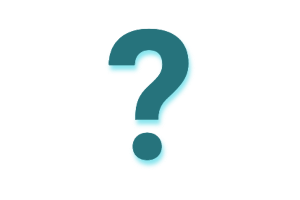
Recent rankings
Latest chart positions across Apple Podcasts and Spotify rankings.
Apple Podcasts
🇫🇷 France - personalJournals
29/06/2025#70🇫🇷 France - personalJournals
23/04/2025#72🇫🇷 France - personalJournals
01/02/2025#96🇫🇷 France - personalJournals
03/01/2025#66🇫🇷 France - personalJournals
28/12/2024#48🇫🇷 France - personalJournals
27/12/2024#37🇫🇷 France - personalJournals
15/11/2024#92🇫🇷 France - personalJournals
13/10/2024#92
Spotify
No recent rankings available
Shared links between episodes and podcasts
Links found in episode descriptions and other podcasts that share them.
See all- https://www.cncdh.fr/
4 shares
- https://creativememory.org/
3 shares
RSS feed quality and score
Technical evaluation of the podcast's RSS feed quality and structure.
See allScore global : 64%
Publication history
Monthly episode publishing history over the past years.
#153 – Rhythm’n’blues. Jump blues, Doo-wop & Soul music. 100 hits de 1942 à 1945
Season 4 · Episode 153
mercredi 12 juillet 2023 • Duration 01:11:19
Belkacem Meziane, musicien professionnel, enseignant, conférencier et chroniqueur pour Soul Bag et New Morning Radio, publie Rhythm’n’blues. Jump blues, Doo-wop & Soul music. 100 hits de 1942 à 1945, aux éditions Le mot et le reste.
Belkacem Meziane nous invite à remonter le temps dans l’anthologie musicale qu’il publie et présente à nos auditeurs et auditrices. Rhythm’n’blues retrace en effet vingt ans de musique, allant de 1942 à 1945, qui donneront naissance à deux nouveaux courants : la soul et le funk.
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, le public noir américain se passionne pour le jump blues, un genre musical nouveau, à la croisée du swing, du blues, du boogie woogie et du gospel.
En 1949, le magazine Billboard crée le top rhythm’n’blues, un terme qui sera désormais adopté par toute l’industrie musicale pour qualifier une diversité de courants allant du boogie woogie de Louis Jordan au doo-wop de The Clovers en passant par la fusion blues/gospel de Ray Charles et le blues survolté de Chuck Berry.
Le rhythm’n’blues propulse alors le marché de la musique populaire noire à l’échelle nationale jusqu’au milieu des années soixante.
Bonne écoute et bel été !
À l’oreille- Louis Jordan – Caldonia (1945)
Titre symbolique du jump blues, un mélange de swing, de blues et de boogie woogie. - Sister Rosetta Tharpe – Up Above My Head, I Hear Music in the Air (1947)
Pionnière de la guitare électrique et du rapprochement entre jump blues/r’n’b et du gospel -
Wynonie Harris – All She Wants To Do is Rock (1949)
Exemple de titre grivois, une spécialité du r’n’b originel - Lloyd Price And His Orchestra – Lawdy Miss Clawdy (1952)
Titre emblématique du r’n’b de New Orleans - Ruth Brown – Mama, He Treats Your Daughter Mean (1953)
La star du label Atlantic et figure féminine du r’n’b -
Clyde McPhatter And The Drifters – Money Honey (1953)
Illustration du rôle de l’humour dans les débuts du r’n’b - The Robins – Riot In Cell Block #9 (1954)
Composition de Jerry Leiber & Mike Stoller, compositeurs phares du r’n’b - Bo Diddley – Bo Diddley (1955)
L’une des premières stars noires du rock’n’roll avec Chuck Berry ou Little Richard -
Bill Doggett – Honky Tonk (1956)
Titre instrumental, un format important du r’n’b - Jackie Wilson – Lonely Teardrops (1958)
Les prémices de la soul de Motown
- Belkacem Meziane, Rhythm’n’blues. Jump blues, Doo-wop & Soul music. 100 hits de 1942 à 1945, Le mot et le reste, 2023
- Belkacem Maziane, This is how we do it, 40 ans de r&b en 100 albums, éditions Le mot et le reste, 2021
- Belkacem Meziane, One the One ! l’histoire du funk en 100 albums, éditions Le mot et le reste
- Radio Cause commune, Le monde en questions, n°39, n°56, n°80, n°92, n°97
ET :
#152 – Ukraine : le double aveuglement
Season 4 · Episode 152
mercredi 5 juillet 2023 • Duration 01:08:11
Hamit Bozarslan, historien et sociologue du fait politique, spécialiste du Moyen-Orient, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), publie Le double aveuglement, aux éditions du CNRS.
ContexteL’effet de sidération provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie de Poutine, dans la nuit du 24 février 2022, est une conséquence de l’aveuglement des pays européens et des États-Unis vis-à-vis de la nature du régime de Poutine. Jusqu’au passage à l’acte, personne ou presque ne croyait (possible) que Poutine, bien qu’ayant massé des troupes sur les frontières de l’Ukraine, envahirait ce pays. Tel est le premier type d’aveuglement dont Hamit Bozarslan fait l’analyse. Avec la chute du Mur de Berlin, l’implosion de l’Union soviétique, la fin de la Guerre froide, les démocraties bourgeoises libérales ont cru à l’avènement de la fin de l’histoire, pensant qu’elles avaient gagné la guerre contre le bloc soviétique et que le temps des passions était désormais révolu. Aveuglées, elles se sont trompées, elles n’ont pas voulu voir tout ce qui pourrait remettre en cause leur conviction, oubliant le rôle que les passions et l’irrationnel pouvaient jouer dans la décision de déclencher une guerre. Elles n’ont aussi par leur inaction (en 2008 en Géorgie), leur démission en 2015 (en Syrie avec la fameuse ligne rouge qui n’en était pas une), leur silence, leur lâcheté, posé aucune limite au projet expansionniste et révisionniste de la Russie poutinienne et à la dérive autoritaire du régime.
Qu’en est-il de l’aveuglement du côté de Poutine et de son régime ? le dirigeant russe est mu par la volonté de reconstituer l’Union soviétique, il se projette dans une vision néo-impériale de la Russie sans comprendre le changement stratégique d’époque qui fait de la Russie d’aujourd’hui un Etat post-impérial. Vouloir reconstruire l’Empire est une forme d’aveuglement, une mission impossible car il manque à la Russie les éléments fondamentaux pour le faire tels qu’analysés au XVIème siècle par Ibn Khaldoun, penseur érudit musulman. Il faut une solidarité égalitaire interne (asabiyya), une idée universelle (da’wa) et un projet d’élévation (avec un esprit de sacrifice) pour construire un empire. Poutine n’a aucune de ses trois cartes en main et sa volonté de reconstituer l’Union soviétique est par conséquent vouée à l’échec. Les théoriciens et idéologues qui l’entourent se trompent en se pensant dans un temps historique de fondation d’empire. L’Empire russe s’est effondré une première fois en 1917 et une seconde en 1990.
Si donc l’Union soviétique est bien morte, si nous ne sommes pass non plus au temps de Catherine II, il convient dès lors de penser la guerre actuelle en Ukraine comme un affrontement entre forces démocratiques et forces antidémocratiques. Si les régimes démocratiques ne sont pas belliqueux, bellicistes, revanchards, et s’ils ne peuvent gagner que les combats menés en leur sein pour davantage de démocratie libérale et davantage de démocratie sociale, ils ne doivent pas pour autant faire preuve de lâcheté et démissionner face à leurs responsabilités nationales et internationales, comme ils l’ont fait durant la guerre d’Espagne, souligne Hamit Bozarslan, en n’aidant pas, au nom de la neutralité, la jeune République espagnole attaquée par les troupes de Franco qui furent sans scrupule aidées par l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste.
À l’oreille- Mykola Lysenko – Opus 8, Rhapsody on Ukrainian themes (Arthur Greene, piano) (00:00 à 4:00)
- Vopli Vidopliassova (VV) – Vesna
- Mykola Lysenko – Opus 8, Rhapsody on Ukrainian themes (Arthur Greene, piano) (8:02 à 14:10)
- Hamit Bozarslan, Le double aveuglement, éditions du CNRS, 2023
- Hamit Bozarslan, Le temps des monstres. Le monde arabe, 2011-2022, Editions La Découvertes, 2022
- Hamit Bozarslan, L’anti-démocratie au XXIème siècle. Iran, Russie, Turquie, éditions du CNRS, 2021
- Hamit Bozarslan, Crise, violence, dé-civilisation : essai sur les angles morts de la cité, CNRS éditions, 2019
- Hamit Bozarslan, Histoire de la violence au Moyen-Orient, de la fin de l’Empire ottoman à Al-Qaïda, Paris, La Découverte, 2008
ET
#143 – À la rencontre de gardiennes et gardiens d’immeubles parisiens
Season 4 · Episode 143
mercredi 25 janvier 2023 • Duration 56:23
Aude de Tocqueville, écrivaine et commissaire d’exposition, publie avec Jean-Michel Djian, journaliste et écrivain, et Margot Lançon, photographe et cinéaste, Éloge des loges. Histoires vraies de gardiennes et gardiens d’immeubles parisiens aux éditions Autrement.
ContexteAude de Tocqueville est allée à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui exercent la profession de gardiens et gardiennes d’immeubles parisiens, propriété d’un bailleur social qui loue un logement social à des ménages contre un loyer modéré, sous condition de ressources. Contrairement à ce qui se passe dans le parc privé, où digicodes et pass ont supprimé des emplois et transformé les loges occupées auparavant par les « concierges », les bailleurs sociaux ont compris le rôle pivot qu’occupent les gardiens et les gardiennes d’immeubles. Ils sont leurs seuls contacts ou représentant sur place face à la multiplicité des locataires.
Si leur métier a considérablement évolué (suppression du cordon, de la délation instaurée par le régime de Vichy), si leurs conditions de travail se sont améliorées (boîte à lettres, allongement du temps de pause durant la journée, pas de travail le samedi, formation continue, revalorisation de la rémunération), il reste un métier difficile qui ne requiert aucun diplôme, même s’il existe un CAP dans ce domaine d’activités. C’est aussi un métier de cooptation. L’essentiel de la journée consiste désormais à recevoir les divers prestataires envoyés par les bailleurs à de fins de maintenance, réparation ou prévenance, etc., ainsi qu’à dresser des états de lieux à l’arrivée ou au départ des locataires. Le métier exige beaucoup de soi. Il faut plutôt avoir un excellent relationnel, savoir écouter, savoir encaisser, ne pas s’épancher (car on le paie toujours). Devoir de discrétion ou réserve, la loge sert de confessionnal et le ou la gardienne fait souvent office d’assistant.e social.e, de conseiller·ère, de soutien, de psychologue : refuge pour les victimes de violences conjugales, dernier lien humain avec les personnes âgées isolées. Ils ou elles voient tout, entendent tout, sont témoins, ont affaire bien plus souvent qu’on le croit à la mort, à la violence, à la drogue, aux descentes de police, etc.
Les vingt témoignages recueillis par Aude de Tocqueville constituent des récits de vie passionnants battant en brèche bien des idées reçues et projettent un regard neuf sur cette profession méconnue. Véritable plongée dans un monde invisible, ils donnent à voir des personnalités engagées au quotidien dans leur travail social avant tout, même s’il comporte aussi une dimension administrative. Elles œuvrent en toute discrétion dans toute la mesure du possible au bien commun, tissant des liens entre les gens, créant du collectif au rebours de l’atomisation de la société et des individus, transformant halls d’immeubles en lieux de convivialité, et cours intérieures où les enfants jouent de moins en moins souvent ensemble en jardins inspirant la sérénité. Mais surtout, ces portraits révèlent combien pour connaître un métier, il faut aller à la rencontre de ceux et celles qui l’exercent, car ils en parlent mieux que personne. En cela recueillir leur parole permet de prendre conscience de leur travail et dévouement en faveur d’un vivre ensemble digne de ce nom, un engagement trop souvent invisibilisé qui mérite pourtant toute notre attention et milite pour une meilleure reconnaissance de leur immense contribution aux processus de socialisation.
À l’oreille- Brigitte Fontaine – Je suis décadente (la concierge gamberge) 1964
- Francis Blanche – Pas d’orchidée pour ma concierge
- Marc Lavoine – Paris
- Aude de Tocqueville, Jean-Michel Djian, Margot Lançon, Eloge des loges. Histoires vraies de gardiennes et gardiens d’immeubles parisiens, Autrement
- Aude de Tocqueville, Atlas des terres sauvages, éditions Arthaud
#53 – La guerre, hier et aujourd’hui : retour d’expériences
vendredi 15 janvier 2021 • Duration 01:29:26
Michel GOYA, historien, ancien colonel des troupes de marine, spécialiste de la guerre moderne, de l’innovation militaire et du comportement au combat, a enseigné à Sciences-Po et l’École pratique des hautes études (EPHE), en parallèle de sa carrière opérationnelle. Auteur de nombreux ouvrages dont Les Vainqueurs (Tallandier, 2018) et S’adapter pour vaincre (Perrin, 2019), il tient également un blog consacré aux questions stratégiques, intitulé La voie de l’épée.
Contexte :Michel Goya analyse comment l’armée française est devenue en 1918 la plus moderne du monde, sinon la plus puissante, après l’effondrement de l’armée allemande, à l’issue d’un processus de transformation unique dans toute l’histoire de la France. En l’espace de 4 ans, elle effectue un saut qualitatif qui la fait passer du pantalon rouge au casque d’acier et au char d’assaut, surmontant le traumatisme de la défaite de Sedan (le 1er septembre 1870), grâce à une industrie de guerre imaginative et performante. La remarquable capacité d’adaptation dont elle fit preuve dès les premiers mois de la guerre et qui ne cessera de se renforcer tout du long, lui permet de vaincre en 1918. Et les vainqueurs, ce sont d’abord les soldats et leurs officiers qui, sur le terrain, font preuve d’ingéniosité et d’une indéniable aptitude au changement, qu’il soit organisationnel, logistique, balistique, opérationnel.Par quel processus l’armée victorieuse en 1918 entame un déclin qui la conduira à la défaite de 1940, à l’issue de ce qu’on appellera la drôle de guerre (3 septembre 1939- 10 mai 1940) ?
Si, bien entendu, de nombreux facteurs politiques, sociaux et internationaux, contribuent à l’explication de cette défaite cinglante, Michel Goya souligne qu’il convient de ne pas négliger d’un point de vue militaire celui de la perte d’un savoir théorique et pratique, l’absence de transmission d’une expérience qui fait qu’une génération plus tard, et sous un nouveau commandement militaire, on n’est plus dans la même configuration.
Quels enseignements en tirer ? qu’est-ce que vaincre ? Si vaincre, c’est imposer sa volonté à l’ennemi ou l’adversaire, cela signifie que l’on se prépare aussi à parler avec lui, à négocier, en vue d’un règlement politique instaurant les conditions d’une paix durable. On ne prend pas la décision politique de faire la guerre pour tuer, même s’il y aura des morts, mais pour obtenir des effets stratégiques. Dans le monopole de la violence par l’État, on se rappellera utilement que l’emploi de la force armée ne sert pas les mêmes objectifs que l’emploi des forces de police, même si la confusion existe parfois, jusqu’à ce que l’analyse correcte de la nature du conflit ne vienne clarifier les choses ou forcer à les voir autrement (exemple de l’évolution de la position de la France face au FLN de 1954 à 1962, au cours de la guerre d’Algérie).
Mais, que se passe-t-il quand on fait la guerre non plus à un État, fût-il déclaré voyou, mais à une nébuleuse terroriste, comme c’est souvent le cas depuis le 11 septembre 2001 ?
Michel Goya revient sur l’engagement de la France au Sahel, de l’opération Serval à l’opération Barkhane. La première s’est traduite par une victoire relative de la France, qui intervient militairement à la demande du gouvernement malien en 2013, considérant que la déstabilisation de la région est une menace pour sa sécurité. C’est la première intervention de la France en Afrique depuis 1979 et elle parvient à stopper l’avancée des groupes AQMI, Ansar Din et Mujavo sur la capitale Bamako, et reprendre les villes de Goa, Tombouctou et Kidal. La France aurait-elle alors dû quitter le Mali, quitte à revenir plus tard ? Elle fait le choix de rester, l’opération change de nom – elle s’intitule désormais Barkhane- , et de nature, puisque sa mission n’est plus de reconquérir un territoire, mais dans le cadre du G5 regroupant les 5 pays du Sahel, de contenir l’activité de groupes terroristes armés (GAT) à un niveau de conflictualité basse, le plus bas possible, pour permettre aux forces locales de prendre la relève.
Or, l’opération commence avec des moyens divisés par 2, par rapport à Serval, dans un contexte de réduction des effectifs et des budgets, au moins jusqu’en 2015, et dans une période où la France est également engagée militairement sur plusieurs autres fronts (en Centrafrique, en Irak et en France où l’armée est mobilisée par l’opération Sentinelle). Autre difficulté, quels effets à court, moyen et long terme, peuvent avoir les formations européennes des armées locales si les problèmes de gouvernance locale persistent (soldes des soldats non payées, fonds détournés, défaillance de l’État dans l’administration et le développement de régions délaissées qui pousse une partie de la population à rejoindre les GAT ? Le coût humain et financier de l’opération Barkhane, sa durée qui atteindra bientôt les limites de l’acceptabilité par l’opinion française, amènera-t-il prochainement la France à revoir son dispositif au Mali ?
Que nous apprend d’autre part la guerre qui a opposé du 27 septembre au 9 novembre 2020, l’Arménie, les forces d’autodéfense arméniennes du Haut-Karabagh à l’Azerbaïdjan. Tout d’abord, souligne Michel Goya, il s’agit d’une guerre entre États. Laquelle fut d’autre part la révélation d’une rupture stratégique, comme il en arrive dans l’histoire du monde tous les 20 à 30 ans, et l’entrée dans une nouvelle séquence historique et géopolitique. Une rupture stratégique qui prend la forme d’un désastre pour l’Arménie. Dès les premiers jours de la guerre, le rapport de forces était nettement en sa défaveur et elle n’a pu ni s’adapter ni renverser la donne en 45 jours. Notons dans cette guerre la disparition de la troisième dimension, grande innovation de la Première guerre mondiale. Le ciel est resté sans avions, peuplé de drones performants, turcs et israéliens, guidant avec précision les tirs atteignant leurs cibles.
L’Arménie était sortie victorieuse de la première guerre du Karabagh (1991-1994), que s’est-il passé en trois décennies ? Quel enseignement tirer du terrain, au-delà des considérations relatives au contexte international et régional, notamment le probable feu vert donné par la Russie à l’Azerbaïdjan, qui lance l’offensive le 27 septembre, avec le soutien de la Turquie ? Michel Goya observe que l’Azerbaïdjan s’est activement et très sérieusement préparé à la guerre, non seulement par l’acquisition de matériel militaire haut de gamme, grâce à l’argent des hydrocarbures, depuis 2000. Mais il a aussi reconstruit patiemment une armée jadis défaite, à l’aide d’une expertise étrangère et diversifiée, durant ces dix dernières années. De son côté, l’Arménie était frappée d’une « inertie consciente », voyant ce qui se passait en face, mais incapable de réagir, de s’adapter, sans doute trop confiante dans la supériorité que lui conférerait in fine le courage et les motivations de ses soldats, quelle que soit par ailleurs leur vaillance. N’évaluant pas non plus correctement les limites de son alliance de sécurité avec la Russie.
Comme souvent dans l’histoire militaire, l’armée auréolée de sa précédente victoire devient conservatrice, rétive au changement et à l’innovation nécessaires face aux évolutions qu’elle perçoit, car cela perturberait son fonctionnement et son mode organisationnel. Ne parvenant pas à se remettre en cause, elle n’est pas en mesure d’anticiper la guerre d’après, et manque de réactivité sous pression et dans l’urgence.
Quelles sont les autres caractéristiques d’ores et déjà notables de la rupture stratégique à laquelle nous assistons ?
À l’oreille :- The Clash – Rock the Casbah
- Rage against the Machine – Killing in the name
- Michel Goya, S’adapter pour vaincre. Comment les armées évoluent, Perrin, 2019
- Michel Goya, Les Vainqueurs. Comment la France a gagné la Grande Guerre, Tallandier, 2018
- Michel Goya, Sous le feu. La mort comme hypothèse de travail, Tallandier, 2015
#52 – Le Congrès de Tours (25-30 décembre 1920), un siècle plus tard
samedi 9 janvier 2021 • Duration 01:08:24
Jean A. Chérasse, cinéaste documentariste, agrégé d’histoire et titulaire du blog « Vingtras » sur Mediapart, auteur de Noël 1920, à Tours. La grande déchirure… Le Congrès fratricide, ouvrage paru aux Éditions du Croquant.
Contexte :Du 25 au 30 décembre 1920, se rassemblèrent dans la salle du Manège de Tours, 285 délégués en provenance de 89 fédérations de la SFIO (Section française de l’Internationale socialiste). Fondée en 1905, la SFIO tenait son XVIIIème Congrès.
À l’ordre du jour, une question : la SFIO, membre de la IIème Internationale, adhèrera-t-elle ou non à la IIIème Internationale. Prendra-t-elle acte de la faillite de la IIème Internationale, proclamée dès 1915 par Lénine, et se soumettra-t-elle aux 21 conditions requises pour adhérer à la IIIème Internationale ?
D’une certaine façon, lorsque s’ouvre le Congrès de Tours, il n’y a pas de suspense et les jeux semblent faits. Les fédérations ont déjà voté massivement pour le oui et les délégués qu’elles envoient siéger à Tours sont porteurs d’un mandat favorable à l’adhésion à la IIIème Internationale.
En effet, la IIème Internationale fait l’objet d’un double rejet, au lendemain de la Première guerre mondiale. Elle fut incapable d’empêcher la Guerre, qui fut une hécatombe, et a échoué dans la mise en œuvre de son programme qui était de réaliser l’union des prolétaires de tous les pays, y compris contre la guerre. En outre, plusieurs de ses représentants en France ont participé à l’Union sacrée, proposée dès le 4 août 1914 à toutes les formations politiques, lesquelles l’acceptent, convaincues que la guerre sera courte et victorieuse, et votent les crédits de guerre, voire pour certains deviennent membres du gouvernement. La IIème est désormais discréditée, et c’est ce qui domine les esprits. En outre, Ludovic-Oscar Frossard, Secrétaire général de la SFIO et Marcel Cachin, Directeur du journal L’Humanité, fondé par Jaurès, se sont rendus au pays de la Révolution d’octobre 1917 et en sont revenus enthousiasmés.
Qu’est-ce qui néanmoins fait du Congrès de Tours un moment historique, un tournant dans l’histoire de la gauche en France ? Quel effet eut sur les participants la lecture du télégramme de Zinoviev ? Quel effet produisit l’arrivée de Clara Zetkin au Congrès, au nez et à la barbe de la police ? Si Jaurès n’avait pas été assassiné le 31 juillet 1914, le cours de l’histoire aurait-il été différent ? Pourquoi, cent ans après un Congrès qui provoqua une scission durable entre socialistes, adhérents de la IIème Internationale et communistes, adhérents de la troisième Internationale, prendre le temps de repenser l’événement, qui a par ailleurs fait l’objet de nombreuses et excellentes études ?
Jean A. Chérasse en étudiant le déroulement du Congrès, ses motions et ses débats, rappelle les attentes dont il était porteur. Il restitue l’atmosphère de fête qui y régnait, celle d’un espoir dans un avenir meilleur, de nouveau à portée de main et suscité cette fois par la jeune Révolution russe d’Octobre 1917, et par la création encore plus récente de la IIIème Internationale en mars 1920. C’est le souffle de la Commune de Paris et de ses 72 journées qui rejaillit sur les participants et anime les débats. Le souvenir partagé d’une expérience révolutionnaire, aux antipodes de ce que sera l’expérience socialiste en Union soviétique, réunit les militants à Tours avant la rupture, le schisme, la déchirure qui traumatisera la gauche française et dont elle porte encore aujourd’hui les stigmates dans son incapacité à s’unir pour définir un objectif commun pour combattre un ennemi commun.
Jean A. Chérasse nous invite à penser les traces et les conséquences toujours vivaces du Congrès de Tours en le mettant en perspective avec l’histoire de la Commune de Paris. Quelle expérience originale et unique de gouvernance instaura-t-elle ? La Commune dont on commémorera, au printemps 2021, le 150ème anniversaire, peut-elle aujourd’hui nourrir le débat de la gauche orpheline d’un projet de société théorique et pratique, émancipateur du collectif et de l’individu ? Que reste-t-il de la Commune? Que fut-elle réellement et que signifia-t-elle vraiment, avant de faire l’objet de récupération ici et là ?
À l’oreille :- Marc Ogeret – L’Internationale
L’Internationale est un chant révolutionnaire, à l’origine un poème d’Eugène Pottier (1816-1887) écrit en 1871 à la gloire de l’Internationale ouvrière, et dont la musique fut composée par Pierre Degeyter (1848-1932) en 1888. Ils sont l’un et l’autre des ouvriers. Ce chant créé en France au sein du mouvement ouvrier est ensuite devenu partout dans le monde l’hymne du prolétariat qui se bat et de la lutte des classes. - Marc Ogeret – La Semaine sanglante
La Semaine sanglante est une chanson révolutionnaire de Jean-Baptiste Clément écrite en 1871 à Paris où il combattait et chantée sur l’air du Chant des Paysans de Pierre Dupont. Elle dénonce le massacre des communards par les Versaillais, l’armée régulière obéissant aux ordres du gouvernement dirigé par Adolphe Thiers et qui siégeait à Versailles. Ce massacre qui fit des dizaines de milliers de victimes fusillées sans jugement du 22 au 29 mai 1871 (environ 30 000), est considéré comme le plus grand massacre de toute l’histoire de Paris. La Semaine sanglante désigne la répression féroce qui mit fin à la Commune de Paris (mars à mai 1871). - Marc Ogeret – La Canaille
La Canaille est un chant révolutionnaire de 1865, précurseur de la Commune de Paris, d’abord appelé La Chanson des gueux. Les paroles sont d’Alexis Bouvier et la musique de Joseph Darcier.
- Jean A. Chérasse, Noël 1920, à Tours. La grande déchirure… Le Congrès fratricide, Éditions du Croquant, 2020
- Jean A. Chérasse, Les 72 Immortelles, Éditions du Croquant, 2019
- Annie Kriegel, Le congrès de Tours 1920 – Naissance du parti communiste français, Paris, Julliard, 1973
- Romain Ducoulombier, Camarades ! La naissance du Parti communiste en France, Paris, Perrin, 2010. Préface de Marc Lazar
- Julien Chuzeville, Un Court moment révolutionnaire, la création du Parti communiste en France (1915-1924), Paris, Libertalia, 2017
- 18ème Congrès tenu à Tours les 25, 26, 27, 28 , 29 & 30 décembre 1920, compte-rendu sténographique, BNF Gallica.
ET :
#51 – Vivre et écrire dans le Kamouraska
samedi 2 janvier 2021 • Duration 01:10:42
Gabrielle Filteau-Chiba, romancière québécoise et militante de la cause environnementale, publie Encabanée, son premier roman, aux éditions Le mot et le reste.
Contexte :Traductrice de formation, Gabrielle Filteau-Chiba a quitté le confort d’une vie citadine à Montréal, sa ville natale au Québec, pour vivre durant trois ans dans les conditions les plus rudimentaires d’une cabane sans eau et sans électricité, perdue dans les forêts du Kamouraska. Encabanée, son premier roman (et premier volet d’un triptyque), est né de cette expérience extrême qui l’a marquée et profondément transformée.
Est-ce la peur de « s’encanailler », de s’embourgeoiser, qui conduit la narratrice à s’encabaner et affronter solitude et coyotes dans les nuits glacées du Bas-Saint-Laurent ? La peur de se laisser vaincre par l’usure du temps, les compromis et les démissions, l’apathie et le cynisme, pousse-t-elle l’ex-étudiante engagée et jeune femme promise à une brillante carrière, à larguer les amarres et vivre sans filet ? Caprice bobo ou décision irréversible ? Coup de tête ? Coup de foudre pour le Kamouraska.
« Fini, la facilité de se démerder en ville, grâce à ta belle gueule », déclare Anouk en se constituant prisonnière de l’hiver, sans grande préparation. Avec comme seule compagnie, celle d’un journal de bord soumis aux aléas de l’encre gelée de sa plume, et celle des souris, ses colocataires.
Comment fait-on pour survivre quand l’eau de la rivière est gelée, qu’il fait moins 40 à l’extérieur et qu’il faut sortir chercher du bois ? Le froid qui vous empêche de dormir. La peur de s’endormir et mourir de froid, car le feu s’est éteint dans la cheminée. La neige pour tout horizon.
L’épreuve du froid comme métaphore. Oui et non. Un baptême du feu. Douter mais ne pas renoncer. Assumer ses rêves et ses illusions. Ses erreurs. Faire l’expérience de ses propres limites. Oser aller au bout de soi-même. Entrer dans le vif du sujet, être et non pas paraître. En quoi vaincre la frilosité libère, est facteur d’émancipation ? En passer par là pour trouver et puiser en soi les ressources inconnues, la force et le courage. La sève et le sel de la vie. La cabane comme une boîte de Pandore. Renaître. Attendre le printemps. Comme une aurore boréale.
Pour Gabrielle Filteau-Chiba, l’écriture n’est pas un exercice futile. Elle passe par une difficile mise à nu de soi-même dans lequel subsiste l’essentiel, délesté du superflu. Il faut éprouver que l’on est soi-même vivant pour prendre réellement conscience de ce qu’est la vie, que les autres sont des vivants, que la nature est vivante et mérite notre respect et notre bienveillance. Engagée dans la lutte environnementale, la romancière québécoise écrit comme elle vit, en harmonie, en osmose avec la nature, dont elle se sent un élément. Sa prose poétique rend hommage aux générations qui nous précèdent, aux Amérindiens, aux premières nations, à la solidarité qui unit tous les vivants. Avec vigueur et fraîcheur, elle porte l’aube d’un monde nouveau. Son récit est celui d’une conversion, la sortie de l’adulescence et l’entrée dans l’âge adulte, celui de l’éco-responsabilité. Planter un arbre, lutter contre la déforestation, en manifestant pacifiquement, en dessinant, en écrivant, sont chaque fois une merveilleuse façon de cultiver l’espoir, de remporter de petites victoires qui, s’ajoutant les unes aux autres, font sens.
Les petites rivières font les grands fleuves.
À l’oreille :- Louis-Jean Cormier – Croire en rien (tiré de l’album « Quand la nuit tombe »)
- Les colocs – Le répondeur (tiré de l’album « Dehors novembre »)
- Patrick Watson – Here comes the River (tiré de l’album « Wave »)
- Gabrielle Filteau-Chiba, Encabanée, Le mot et le reste, 2020 (première parution au Québec, aux éditions XYZ, inc., 2018)
- Anne Hébert, Kamouraska, Le Seuil, 1970
ET :
#50 – Liban : retour sur un an de « révolution avortée »
mercredi 23 décembre 2020 • Duration 01:08:10
Aurélie Daher, enseignante-chercheuse à l’Université Paris-Dauphine et Sciences Po Paris, spécialiste du Liban, et notamment du Hezbollah.
Contexte :Le 17 octobre 2019, débutait au Liban un mouvement de contestation civile. Des manifestations pacifiques se déroulaient à Beyrouth comme dans les principales villes du pays, pour dénoncer la corruption de la classe politique dirigeante et son incurie. Un quart de la population du pays, toutes confessions confondues, est descendu dans la rue pour appeler au renouvellement des élites dirigeantes issues des partis confessionnels.
Qu’en est-il un an plus tard ?Que sont devenues les aspirations populaires à la déconfessionnalisation du paysage libanais, à l’émergence d’une nouvelle citoyenneté, d’un autre mode de fonctionnement institutionnel ? Force est de constater, observe Aurélie Daher, que la crise économique et bancaire que traverse le pays, la plus grave de toute son histoire, et frappant tous les citoyens, a fait de la survie de chacun et chacune, de chaque famille, une priorité. La paupérisation des classes moyennes et l’aggravation de la précarité des plus faibles, a augmenté l’insécurité, y compris alimentaire. La livre libanaise s’est considérablement dépréciée face au dollar, l’argent des particuliers placé dans les banques est bloqué ou réduit en fumée, ceux qui parviennent à nourrir leurs familles n’ont les moyens ni de payer leur traitement médical ni de financer les études scolaires et universitaires de leurs enfants dans un pays où l’enseignement est largement privé et communautaire.
Cependant avant même que la crise économique, bancaire, et sanitaire, étrangle le pays, les vieux réflexes et démons communautaires avaient repris le dessus sur la contestation transversale. La démission du Premier ministre, Saad Hariri, le 29 octobre 2019, et l’impossibilité de trouver un autre leader sunnite pour le remplacer, a bouleversé l’équilibre multiconfessionnel du système politique qui répartit le pouvoir et les ressources du pays entre les trois principales communautés. En effet, conformément à la Constitution en vigueur, le président du Liban doit être maronite, le premier ministre sunnite et le président de la Chambre des députés chiite, et conformément à l’interprétation de cet équilibre institutionnel, toute atteinte à cet équilibre doit se traduire par un jeu à somme nulle dans lequel les trois groupes religieux doivent soit tous perdre soit tous gagner. Ainsi, les sunnites se sont-ils désolidarisés de la contestation quand ils estimèrent que seule leur communauté avait perdu au jeu, alors que les chrétiens et les chiites n’avaient, quant à eux, pas été touchés par la démission de leurs dirigeants respectifs. En sonnant la fin de la récréation, le 24 octobre, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, avait appelé les manifestants chiites à rentrer chez eux, ce qu’ils firent. Les Druzes aussi finirent par rentrer dans le rang. Quant aux chrétiens, majoritairement maronites, ils étaient divisés : les partisans de Michel Aoun n’étaient pas descendus dans la rue pour exiger sa démission, contrairement à ceux de Samir Geagea. Dans un État clientéliste, pour trouver et conserver un emploi, ou pour qu’aboutisse la moindre démarche administrative ou relevant de la vie quotidienne, il vaut mieux passer par sa communauté et faire allégeance à ses leaders. Rares sont ceux qui ont les moyens de s’en affranchir et d’y résister.
Ajoutons encore que, sur la scène internationale, les mouvements sociaux de citoyens descendant dans la rue pour défendre leurs droits, appeler à un changement politique ou exprimer leur colère, au cours de l’année 2019 (en Irak, au Liban, en Algérie, au Chili, à Hong Kong, en Bolivie, au Venezuela, sans compter en Europe, les Gilets jaunes en France, les Catalans en Espagne, les pro et les anti-Brexit au Royaume-Uni), ont marqué le pas en 2020, la crise du covid ayant limité les possibilités de rassemblements collectifs, la lassitude ou la crise économique ayant fait le reste, sans oublier la répression et l’interdiction pure et simple de manifester.
Au Liban, il n’y eut donc de révolution qu’en termes de mécanique céleste. Retour à la case départ ou presque, constate Aurélie Daher. Un an plus tard, Saad Hariri a retrouvé son poste de premier ministre. L’espoir de voir aboutir l’enquête relative à l’explosion du port de Beyrouth (qui fit, le 4 août dernier, 200 morts, et plus de 6000 blessés et 250 000 sans-abris), inculper et condamner des responsables politiques, est sans doute illusoire dans ces conditions, malgré les attentes des victimes ou celles de leurs familles, étant donné le fonctionnement du système. Les dirigeants communautaires au pouvoir semblent insubmersibles et inamovibles, le blocage et la paralysie d’autant plus insurmontables qu’aucun leadership alternatif, aucune nouvelle figure politique n’a émergé durant la contestation civile, laquelle fut rejointe par des opportunistes de tous bords et vieux routiers de la politique libanaise.
Le Liban s’enfonce dans la crise. Quatre mois après l’explosion du port, Paris et les autres partenaires internationaux du Liban attendent hypothétiquement de ses dirigeants qu’ils réforment le pays en profondeur pour lutter contre la corruption, la gabegie, le clientélisme et l’opacité dont la population libanaise est la première victime. Sans ces réformes, il n’y aura pas davantage de fonds collectés que l’aide d’urgence de 280 millions de dollars débloqués, dont une grande part en farine après la destruction des silos de blé et réserves dans l’explosion portuaire. Or, toute la question est de savoir si la classe politique en place est capable de telles réformes. La levée temporaire et partielle du secret bancaire sur les comptes de la Banque du Liban (BDL) et ceux des institutions publiques permettra-t-elle de relancer l’audit juriscomptable de la BDL ou bien est-ce une nouvelle manœuvre pour gagner du temps ? L’Arabie saoudite avait dans le passé porté secours au Liban afin de soutenir la livre libanaise et les liquidités en devises des banques, de renforcer la stabilité du système financier et apaiser les tensions sur le marché. Ryad avait par exemple renfloué les caisses de l’État libanais, en juillet 2006, par le dépôt d’un milliard de dollars à la Banque centrale libanaise. Elle l’avait déjà fait en 1997, avec un dépôt de 500 millions de dollars.
Mais, désormais, Ryad est moins disposé à injecter de l’argent ou se porter garant des obligations financières du pays, n’ayant pas apprécié d’avoir été accusé par Beyrouth (et notamment par le président Michel Aoun)de détenir le Premier ministre libanais, Saad Hariri, lequel avait annoncé sa démission depuis le royaume saoudien, le 4 novembre 2017. Quant aux autres partenaires, ils sont aussi aux prises avec leurs propres difficultés économiques.
De quoi demain sera-t-il fait ? Des temps sombres en perspective ?Aurélie Daher note que les Libanais survivent aujourd’hui grâce à l’aide, au soutien et à la solidarité de leur diaspora.
À l’oreille :Trois extraits de l’épopée historique musicale intitulée Saïf 840 (Eté 1840) créée et écrite par Mansour Rahbani, en 1988 et reprise ensuite par Élias, Marwan, Ghady et Oussama Rahbani en 2009.
La pièce musicale retrace l’histoire mouvementée de cet été chaud où depuis la ville d’Antélias et au sein d’un groupe de résistants multi-communautaires, naît une offensive contre la répression des forces occupantes. Les turbulences de l’histoire libanaise, à travers musique, chant et danses : ses révoltes et ses combats, ses personnages courageux, pittoresques et attachants, ses histoires d’amour. Dans une fresque poétique, au succès non démenti, Mansour Rahbani déconstruit l’histoire pour en souligner sa part d’illusion et de désillusion, mais aussi les volontés, les rêves, les contradictions et les utopies qui ont la vie dure.
- Mansour Rahbani – Al Maaraka
- Mansour Rahbani – Ya Hayya Allah
- Mansour Rahbani – Beirut
#49 – L’Iran, année 2020 : bilan et perspectives
vendredi 18 décembre 2020 • Duration 01:02:23
Clément Therme, spécialiste de l’Iran, est un chercheur post-doctorant au sein de l’équipe « Savoirs nucléaires » du CERI à Sciences Po Paris. Il est également membre associé de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et l’auteur des Relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979 (PUF, 2012).
Il a également dirigé la publication d’un ouvrage collectif, L’Iran et ses rivaux, Entre nation et révolution, paru aux éditions Passés/Composés en février 2020.
Contexte :L’Iran fut marqué en 2020 par un certain nombre de coups durs portés par ses adversaires. L’assassinat, le 27 novembre dernier, du scientifique Mohsen Fakhrizadeh, figure historique du nucléaire iranien, ravive le souvenir de l’assassinat, le 3 janvier 2020, du général Qassem Soleymani, commandant des forces Al-Qods, chargées des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution.
La guerre au Sud Caucase qui a opposé, du 27 septembre au 9 novembre 2020, l’Arménie à l’Azerbaïdjan, eut notamment pour conséquence de fragiliser durablement la frontière nord de l’Iran, jusqu’ici stable. Des combats opposant les forces d’autodéfense du Haut-Karabagh et les forces armées arméniennes aux forces azerbaïdjanaises, s’y sont déroulés à proximité, entraînant mobilisation de troupes et causant des victimes aussi, côté iranien. La défaite de l’Arménie a permis d’autre part la création d’un corridor à la frontière iranienne, traversant l’Arménie et reliant la province du Nakhitchevan à l’Azerbaïdjan.
En outre, l’implication de la Turquie dans le conflit aux côtés de l’Azerbaïdjan a introduit un nouvel acteur dans la région, qui inquiète l’Iran et la Russie, deux Etats n’ayant par ailleurs de mauvaises relations ni avec l’Arménie ni avec l’Azerbaïdjan. La présence de miliciens et mercenaires djihaddistes venus de Syrie, via la Turquie, est un facteur supplémentaire de déstabilisation dans la zone. Enfin, ni les États-Unis ni Israël n’ont caché tout au long des années post-soviétiques l’intérêt qu’ils portaient à l’Azerbaïdjan, non seulement pour ses hydrocarbures et le tracé des oléoducs et gazoducs, mais aussi pour le poste d’observation stratégique unique que cet État devenu indépendant en 1991 offre sur l’Iran ; et cela sans commune mesure avec le cadre conflictuel arméno-azerbaïdjanais strictement parlé.
Pour autant, souligne Clément Therme, si l’isolement de l’Iran n’a cessé de se renforcer sur la scène internationale, avec notamment, les accords historiques de 2020 visant à la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis (EAU), Bahrein, le Soudan et le Maroc, il convient de noter que l’assassinat de Qassem Soleimani, l’architecte de l’influence iranienne au Moyen-Orient, a eu aussi pour effet secondaire d’attirer les regards sur la présence contestée des États-Unis en Irak. Si l’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh est un avertissement pour les scientifiques iraniens, l’intimidation n’a jusqu’à ce jour jamais fait renoncer l’Iran à l’enrichissement d’uranium, et le meurtre du scientifique permet aussi opportunément au régime de pointer les méthodes de services secrets opérant sur des territoires extérieurs afin de neutraliser des cibles, sans considération pour les droits de l’homme.
En outre, pour contrer son isolement, l’Iran s’est rapproché de la Chine et de la Russie, s’éloignant davantage des Américains et des Européens.
Reste que la politique de « pression maximale » sur l’Iran de l’administration Trump, le retrait des États-Unis de l’accord de Vienne, en mai 2018, le rétablissement des sanctions internationales qui n’avaient été que partiellement levées, pèsent lourdement sur le pays et sa population qui connaît une grave crise économique, préexistante et aggravée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19. Même si l’Iran a déclaré que le nom du gagnant de l’élection présidentielle américaine lui importait peu et que seule importerait la politique que mènera le futur Président, l’élection de Joe Biden est porteuse d’attentes pour l’amélioration des relations entre les États-Unis et l’Iran. Si elle se produisait, cette dernière néanmoins n’aura pas lieu du jour au lendemain et ses effets directs sur la situation économique et sociale du pays ne seront sans doute pas immédiats. Quatre dossiers doivent trouver leur règlement, celui du nucléaire, celui de l’influence régionale (hégémonique) de l’Iran, celui de son programme balistique, et celui des droits de l’homme. Sans compter la nature idéologique du régime qui complique la donne. La collaboration nucléaire entre la France et l’Iran par exemple n’était pas un problème au temps du chah et d’un Iran, membre du Pacte de Bagdad.
Si, dans sa tentative de rapprochement et de normalisation avec l’Iran, Barack Obama s’était appuyé sur la Russie, l’arrivée au pouvoir de Joe Biden s’effectuera dans un contexte de dégradation relative des relations américano-russes rendant plus difficile aujourd’hui de passer par cette voie. Quelles sont alors les autres voies, face à un régime qui se crispe et réprime par crainte d’un scénario à la Gorbatchev, où la tentative de réformer de l’intérieur l’Union soviétique a précipité son implosion? Le 12 décembre dernier, l’exécution par pendaison de l’opposant et journaliste, Rouhollah Zam, réfugié politique en France, qui s’était rendu en Irak où il a été enlevé, en 2019, est un avertissement aux opposants exilés, de ne pas se risquer à lutter contre le régime, à ses frontières ou à l’intérieur.
Les élections présidentielles iraniennes en juin 2021 pourront-elles avoir un enjeu autre que celui du taux de participation des électeurs ? Quels sont les débats parcourant actuellement la société iranienne ? La population lassée d’une parodie d’alternance entre modérés et conservateurs, se mobilisera-t-elle pour les uns ou les autres, alors que le vrai pouvoir en Iran n’est pas entre les mains du Président de la République islamique, mais entre celles du Guide suprême de la Révolution, l’actuel ayatollah Ali Khamenei ? La bataille pour la succession de ce dernier a-t-elle déjà commencé ?
À l’oreille :
- Kiosk – Eshgh e Sorat
- DasandazBand – Hey Joseph | دسندازبند – هی جوزف
- Gougoush – Respect
La chanteuse reprend le très culte « Respect » d’Aretha Franklin, geste à la symbolique énorme dans un pays où les droits des femmes sont un combat quotidien
- Clément Therme (sous la direction de), L’Iran et ses rivaux. Entre nation et révolution, éditions Passés/Composés, 2020. Avec les contributions d’Annick Cizel, Thierry Kellner, Clément Therme, Hayk A. Martirosyan, Massoud Sharifi Dryas, Michel Duclos, Elisabeth Marteu, François Nicoullaud, Louis Blin, Élodie Brun, Marc-Antoine Pérouse de Montclos.
- Clément Therme, Les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979, Préface de Mohammed-Reza Djalili et Farhad Khosrokhavar, The Graduate Institute Geneva, PUF, 2012
- Radio Cause commune, Le monde en question, n°22
- Barack Obama, Une terre promise, Fayard, 2020
ET
#48 – Contournements successifs des processus démocratiques en France : quels impacts sur l’État de droit ?
vendredi 4 décembre 2020 • Duration 59:34
- Michel Tubiana, ancien Président de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), représentant de la LDH auprès de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), et rapporteur de l’avis sur la proposition de loi relative à la sécurité globale, en date du 26 novembre 2020.
- Jean-Claude Samouiller, vice-Président d’Amnesty International France, représentant de cette ONG auprès de la CNCDH, et rapporteur de la déclaration sur l’état d’urgence sanitaire, en date du 26 novembre 2020. Contexte :
- Jean Ferrat – Ma France
- Georges Moustaki – Ma liberté
- L’avis de la CNCDH sur la proposition de loi relative à la sécurité globale, Proposition de loi relative à la sécurité globale – Une nouvelle étape de la dérive sécuritaire en France
- La déclaration de la CNCDH sur l’état d’urgence sanitaire, Déclaration sur l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse sur les préoccupations de la CNCDH concernant les détournements des processus démocratiques et qui fait écho aux deux avis sus mentionnés
- La Commission nationale consultative sur les droits de l’homme
- Ligue des droits de l’Homme
- Amnesty International
- Radio Cause commune, Le monde en question n°30, Stop-covid : vers une surveillance de masse généralisée, avec la participation de Patrice Franceschi et Célia Zolynski)
- Radio Cause commune, Le monde en question n°36, La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie : le rapport 2019 de la CNCDH, avec la participation de Nonna Mayer, Célia Zolynski et Tommaso Vitale).
Créée en 1947, sous l’impulsion de René Cassin, la CNCDH est l’institution nationale de promotion et protection des droits de l’homme française, accréditée de statut A par les Nations unies. Elle est le rapporteur national indépendant sur la lutte contre toutes les formes de racisme depuis 1990, sur la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains depuis 2014, sur la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’Homme depuis 2017, et sur la lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBTI depuis avril 2018.
Composée d’experts et de représentants d’organisations non-gouvernementales issues de la société civile, telle que la Ligue des Droits de l’Homme et Amnesty International France, la CNCDH rend des avis et fait des déclarations sur les sujets relevant de ses champs de compétences, lorsque des projets de loi ou des mesures gouvernementale portent ou sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés fondamentales des citoyens, aux principes constitutionnels et au bon fonctionnement des institutions démocratiques.
Michel Tubiana et Jean-Claude Samouiller, deux grandes figures militant depuis de nombreuses années pour la défense des droits de l’Homme, regrettent que la Commission n’ait pas été une fois de plus saisie par les pouvoirs publics, ce qui ne l’empêche d’ailleurs pas d’user de son droit à l’auto-saisine. C’est ce qu’elle a fait, le 26 novembre 2020, en rendant un avis sur la proposition de loi relative à la sécurité globale (et dont Michel Tubiana fut le rapporteur), ainsi qu’en faisant une déclaration sur l’état d’urgence sanitaire (dont Jean-Claude Samouiller fut le rapporteur).
En quoi la proposition de loi relative à la sécurité globale, examinée présentement par le Sénat, alarme la CNCDH ?Ce texte redessine de manière préoccupante les contours d’une nouvelle « donne sécuritaire », sans consultation préalable, et porte atteinte à de nombreux droits fondamentaux. Il est créateur d’une insécurité juridique et de risques d’arbitraire, en élargissant (à titre expérimental, sur certaines parties du territoire national) les compétences régaliennes de la police nationale à la police municipale ainsi qu’aux agents de sécurité privée, qui seraient en outre désormais dispensés de toute habilitation et agrément par l’État. Si la mobilisation massive des organisations syndicales des journalistes et de l’opinion publique, ont contraint le pouvoir à revoir sa copie concernant la modification de l’article 24, pour autant cela n’atténue pas les craintes qu’il suscite. En effet, combiné au nouveau Schéma national de maintien de l’ordre, il remet en question une conception transparente et contrôlable de l’usage de la force dans une démocratie, et constitue une atteinte potentielle à l’exercice du droit à l’information ainsi qu’aux droits des victimes de violences policières. Enfin Michel Tubiana souligne que la CNCDH s’inquiète du recours massif aux dispositifs de surveillance aéroportée (drones), aux technologies issues de l’intelligence artificielle, à des fins de dissuasion et d’intimidation, ce qui ne peut que contribuer à accroître la méfiance et la défiance dans un contexte de relations dégradées entre la police et les citoyens.
L’absence de débat démocratique sur l’emploi de telles technologies et leurs conséquences sur les libertés fondamentales est une source d’inquiétude.Dans la déclaration relative à l’état d’urgence sanitaire dont Jean-Claude Samouiller fut le rapporteur, la CNCDH s’inquiète de l’adoption par décret de mesures restrictives des droits et libertés. Une dérogation au cadre juridique de l’État de droit nécessite un encadrement de sa mise en œuvre et de sa durée. La compétence exclusive du Parlement pour restreindre les droits et les libertés doit être respectée et implique de limiter le recours à l’état d’urgence sanitaire aux seules situations où le Parlement ne peut se réunir. Ce qui n’est pas le cas actuellement. Quelle est la légitimité de mesures non fondées sur le choix du législateur ? En tout état de cause, Jean-Claude Samouiller rappelle que les mesures prises, compte tenu de situations exceptionnelles, doivent respecter les principes de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité. La CNCDH s’inquiète de la fiabilité de la remontée des données, du choix de fermer les activités considérées comme non essentielles, du traçage numérique via l’application tous-anti-covid, de l’impact des mesures restrictives de liberté sur les plus précaires et les plus fragiles, alors que demeure l’inadéquation des moyens humains et matériels pour faire face à la crise épidémiologique.
L’absence de dialogue social est préjudiciable, comme l’est l’absence de débat démocratique mentionnée plus haut, alors que se banalise l’état d’exception en cours, depuis de nombreuses années, tant sur le fond du droit, avec la réinstauration de l’état d’urgence sanitaire que sur la procédure législative, avec l’adoption en mode accéléré de projets de lois ou la propension à légiférer par ordonnances. Le renforcement des pouvoirs de l’exécutif se fait au détriment des pouvoirs législatif et judiciaire. La CNCDH regrette que les pouvoirs publics s’engagent sur une voie toujours plus répressive et optent pour des moyens accrus de surveillance, sans concertation avec la société civile et sans aucun égard pour le respect des droits fondamentaux.
Liberté de réunion, liberté de manifester, respect de la vie privée, protection des données de santé individuelles, telles sont quelques-uns des principes constitutionnels et libertés fondamentales remis en cause, directement ou subrepticement, dans le pays de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Comment sommes-nous progressivement tous devenus des « suspects » aux yeux de nos gouvernants ? Depuis quand le citoyen est-il considéré, non plus comme un sujet de droits et d’obligations, mais comme une menace telle que l’État s’arroge désormais le droit de surveiller non seulement nos actions, mais aussi nos opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ? Pourquoi et comment l’exception se banalise au point de devenir la règle ? Est-il encore possible de renverser la tendance et de refaire de la défense des droits de l’homme et de la planète la priorité ? Comment sauver l’État de droit face aux dérives autoritaires et répressives ?
À l’oreille :ET
#47 – Beata Umubyeyi Mairesse : l’écriture et la parole pour faire face à l’indifférence
vendredi 20 novembre 2020 • Duration 01:10:01
L’écrivaine Beata Umubyeyi Mairesse, auteure d’un premier roman salué par la critique, Tous tes enfants dispersés (Autrement, 2019), livre quelques-unes de ses réflexions sur le rôle de la littérature, patrie de la liberté, à l’occasion de la republication, à l’automne 2020, de ses recueils de nouvelles, Ejo suivi de Lézardes, et autres nouvelles aux éditions Autrement.
Contexte :Fille unique, issue d’un mariage mixte. Blanche par son père. Noire par sa mère. Enfant passionnée de lecture. Née à Butare, la grande ville universitaire du sud du Rwanda. Langue maternelle, le kinyarwanda, mais scolarisée dès son plus jeune âge à l’École internationale belge de sa ville natale où elle reçoit un enseignement en français. Condamnée à mort en avril 1994, comme sa mère et les siens, parce que Tutsi, Beata Umubyeyi Mairesse échappe aux machettes et aux gourdins en se cachant, et en se faisant passer pour Française en traversant la frontière avec le Burundi voisin.
Elle arrive en France à la fin du mois de juillet 1994, où elle finit ses études et réside depuis.
Survivante, elle mesure mieux que quiconque, comme chaque rescapé du génocide des Tutsi au Rwanda, comme tout rescapé d’une entreprise d’extermination, ce que cela veut dire. Elle appréhende néanmoins le statut de survivante qui lui colle désormais à la peau, non pas qu’elle le récuse, mais elle se méfie viscéralement de toute visée simplificatrice, de toute étiquette dont on affuble l’autre, pour mieux maîtriser son étrangeté, son altérité. Car elle y voit potentiellement un encouragement à refermer précipitamment un livre, plutôt que de l’ouvrir, une invitation opportune à rester dans sa propre zone de confort, d’où prolifèrent l’indifférence, l’aveuglement, la surdité.
Beata Umubyeyi Mairesse a donc pris le parti d’écrire, d’écrire de la fiction plutôt que de témoigner directement, et ses livres sont traversés par la question de la pluralité des identités. Identités assignées, identités voulues, identités assumées.
Que faire de données pour ainsi dire initiales, reçues en partage, héritées sans testament ? Comment chacun construit sa vie en cheminant seul ou avec d’autres pour parvenir à une forme d’apaisement ? L’inaliénable liberté de tout être humain ne réside-t-elle dans la possibilité de choisir, de réfléchir ses identités et de travailler sur elles, plutôt que de les subir par la force, la violence, ou le simple regard discriminant des autres et dépourvu d’empathie ?
De quels fils conducteurs et bigarrés est tissée l’œuvre de Beata Umebyeyi Mairesse ? Si elle a choisi la fiction romanesque, c’est pour désenclaver le débat, accéder à l’universel par la singularité de ses personnages, femmes, enfants, mères, fils.
En se mettant à la place du lecteur, en l’accompagnant en douceur jusqu’aux bords du gouffre que sont les existences des survivants. Elle y parvient en empruntant au genre littéraire de la nouvelle toute sa force elliptique et sa puissance de suggestion. Non pas tant parce qu’il n’est pas possible ou besoin de tout dire, que parce qu’il est difficile de tout entendre, ou de supporter bien longtemps le récit de l’insoutenable. Sans doute aussi le choix de la nouvelle correspond-il à un pari qu’elle fait, une fois encore en se mettant à la place des autres, de ses lecteurs notamment auxquels elle voue une immense attention : les voies sont multiples pour sortir du tropisme de l’indifférence. On ne sait jamais d’avance comment se produira le déclic, ce miracle de l’écriture et ce miracle de la lecture, faisant passer le lecteur de l’absence d’empathie à la sympathie, à l’émotion d’un partage avec l’auteur et à la conscience d’une commune appartenance au genre humain.
Pourquoi la nouvelle n’est-elle pas qu’un galop d’essai dans le parcours littéraire de Beata Umubyeyi Mairesse ? Pourquoi, même en écrivant des romans, elle ne renonce pas à ce genre littéraire ? Peut-être parce que c’est la façon qu’a l’écrivaine de rester ainsi dans la proximité du kinyarwanda, qu’elle ne maîtrise plus aussi bien qu’auparavant, mais dont elle a conservé la richesse d’une langue métaphorique, concise, poétique, sa part inaltérable d’oraliture faisant irruption dans le texte français, comme ce mot « Ejo », titre de son premier recueil de nouvelles, signifiant à la fois « hier » et « demain ».
Et enfin, comment ne pas si demander si la nouvelle n’est pas la façon la plus percutante de dire la complexité du réel, que l’unité ne s’élabore qu’à partir d’une multiplicité ; que , loin de détruire cette dernière, elle la fortifie ; qu’au discours de haine stigmatisant, simplificateur, réducteur, il faut opposer partout et toujours la pluralité des récits et des voix, fragments de vie, rappelant l’interdiction de tuer, de toucher à l’intégrité physique et morale de tout être humain ?
À l’oreille :- Chant choral en kinyarwanda – Akabyino ka nyugoruru (« La petite danse de Grand-mère »), texte du poète Cyprien Rugamba, tué aux premiers jours du génocide de 1994, et cité à la fin du roman de Beata Umubyeyi Mairesse, Tous tes enfants dispersés (Autrement, 2019).
- Blick Bassy – Ngwa dans l’album intitulé 1958
- Frédéric Chopin – Berceuse Des-dur, opus 57, œuvre pour piano en ré bémol jouée par Arthur Rubinstein
- Beata Umubyeyi Mairesse, Ejo, suivi de Lézardes et autres nouvelles, Autrement, 2020 (édité aux Éditions La Cheminante en 2015 et 2017. Ejo reçut le Prix François Augiéras, en 2016 et Lézardes, le Prix de l’Estuaire- Prix du Livre Ailleurs, en 2017.
- Beata Umubyeyi Mairesse, Tous tes enfants réunis, Autrement, 2019. Le livre est nominé pour plusieurs prix littéraires (Prix Wepler, Prix André Malraux, Prix Jean Giono, Prix du premier roman de la SGDL)
- Beata Umubyeyi Mairesse, Après le progrès, 45 poèmes en prose, éditions La Cheminante, 2019.
- Beata Umubyeyi Mairesse, Le fardeau de la femme blanche, nouvelle publiée dans La Nouvelle Revue Française, août 2019
- Radio Cause commune, Le monde en question, n°29
Et