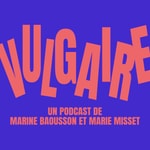Choses à Savoir - Culture générale – Details, episodes & analysis
Podcast details
Technical and general information from the podcast's RSS feed.

Choses à Savoir - Culture générale
Choses à Savoir
Frequency: 1 episode/1d. Total Eps: 2001

Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Recent rankings
Latest chart positions across Apple Podcasts and Spotify rankings.
Apple Podcasts
🇫🇷 France - education
28/07/2025#1🇫🇷 France - General
28/07/2025#29🇫🇷 France - education
27/07/2025#1🇫🇷 France - General
27/07/2025#32🇫🇷 France - education
26/07/2025#1🇫🇷 France - General
26/07/2025#27🇫🇷 France - education
25/07/2025#1🇫🇷 France - General
25/07/2025#31🇫🇷 France - education
24/07/2025#1🇫🇷 France - General
24/07/2025#30
Spotify
🇫🇷 France - top
28/07/2025#196↗🇫🇷 France - trending
28/07/2025#58↗🇫🇷 France - trending
27/07/2025#63↗🇫🇷 France - top
27/07/2025#199↘🇫🇷 France - trending
26/07/2025#66↗🇫🇷 France - top
26/07/2025#197↘🇫🇷 France - top
25/07/2025#194→🇫🇷 France - trending
25/07/2025#71↘🇫🇷 France - top
24/07/2025#194↘🇫🇷 France - trending
24/07/2025#56↘
Shared links between episodes and podcasts
Links found in episode descriptions and other podcasts that share them.
See all- https://www.instagram.com/p
11467 shares
RSS feed quality and score
Technical evaluation of the podcast's RSS feed quality and structure.
See allScore global : 53%
Publication history
Monthly episode publishing history over the past years.
Pourquoi les tests de QI ont-ils été détournés ?
vendredi 30 août 2024 • Duration 02:05
Rediffusion
Les tests chargés d'évaluer l'intelligence d'un individu ont été élaborés en 1905 par le pédagogue français Alfred Binet et ses collaborateurs. Ces tests de QI (Quotient intellectuel), qui étaient censés déterminer l'"âge mental" de l'enfant, ont été élaborés à la duite d'une demande du Ministère de l'Instruction publique, comme on l'appelait alors.
À la suite des lois de 1881-1882, qui rendent l'école primaire obligatoire et gratuite, les autorités éducatives se sont aperçues que tous les enfants n'étaient pas en mesure de suivre l'enseignement prévu pour eux.
Le Ministère souhaitait donc disposer d'une mesure objective des capacités intellectuelles de chacun d'entre eux, de manière à pouvoir créer des classes spécifiques, destinées à accueillir les enfants les plus en difficulté.
Le but était donc de repérer ces élèves, grâce à ces tests de QI, de manière à leur dispenser des cours adapté et un soutien approprié.
Ces tests ont fait l'objet de certaines critiques. C'est ainsi que leur concepteur, qui prétendait ne mesurer que le processus intellectuel, et non les connaissances, s'appuyait tout de même sur certains acquis pour construire ses tests.
Une tout autre utilisation
Les tests de QI, cependant, ont parfois été utilisés à d'autres fins, bien moins avouables. En effet, aux États-Unis, ou dans certaines provinces de Canada, à la fin des années 1920, des personnes ayant eu de faibles résultats aux tests de QI étaient obligées de se soumettre à des programmes de stérilisation forcée.
On connaît au moins le cas d'une personne qui, ayant poursuivi les autorités canadiennes à cette occasion, a obtenu gain de cause.
Cette instrumentalisation, à des fins eugénistes, des tests de QI, n'est pas la seule dérive constatée. En effet, certains auteurs ont constaté que les représentants de certaines minorités, comme les Noirs, avaient parfois des résultats plus médiocres aux tests de QI.
Ils ont alors expliqué ces différences de scores, entre les uns et les autres, par des raisons, souvent fondées sur la génétique, qui ont paru racistes à certains observateurs. Pout ces derniers, ces écarts s'expliquaient surtout par la nature de l'environnement social.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Comment des pigeons ont aidé l'agence Reuters ?
jeudi 29 août 2024 • Duration 02:13
L'agence Reuters est, aujourd'hui encore, l'une des plus importantes agences de presse. Présente dans plus de 90 pays, elle emploie près de 50.000 personnes, dont 2.500 journalistes.
Elle est fondée en 1851 par Paul Julius Reuter. Né en Allemagne en 1816, ce fils de rabbin travaille d'abord dans une banque fondée par l'un de ses oncles, ouvre une librairie puis fonde un journal, sans plus de succès.
Après toutes ces tentatives infructueuses, il débarque à Paris en 1848. Il y rencontre Charles Havas, qui a fondé, dès 1835, l'agence de presse du même nom. La collaboration entre les deux hommes ne dure qu'un an.
Un départ vers l'Allemagne
Si Reuter ne reste pas longtemps chez Havas, c'est qu'il ambitionne de fonder sa propre agence de presse. C'est chose faite dès 1849. Mais l'agence ouverte à Paris, qui transmet des nouvelles internationales aux journaux français, doit fermer au bout de quelques mois. Étant étranger, en effet, Reuter ne peut exercer une telle activité.
Il quitte alors la France pour se rendre à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, où il fonde une nouvelle agence. Un choix qui ne doit rien au hasard. En effet, c'est dans cette ville que se trouve le terminal du réseau télégraphique en provenance d'Allemagne.
Reuter sera donc bien placé pour recevoir un flot d'informations, qu'il pourra ensuite diffuser en Belgique et en France.
Des pigeons voyageurs à la rescousse
Il se trouve cependant confronté à un sérieux problème. Il n'existe pas de télégraphe entre Aix-la-Chapelle et Bruxelles. Dès lors, comment acheminer les nouvelles vers la capitale belge et, de là, en direction de Berlin et Paris ?
Reuter trouve alors une solution ingénieuse : il utilise des pigeons voyageurs. À vrai dire, le recours à ces oiseaux n'était pas nouveau, puisque Charles Havas y avait déjà pensé.
Reuter réunit donc 200 pigeons qui, se déplaçant plus vite que les trains postaux, lui transmettent les nouvelles plus rapidement. Il prend donc connaissance de ces informations avant ses collègues, ce qui assure un avantage décisif à son agence.
Mais la chance l'abandonne dès 1851, date à laquelle le télégraphe est posé sur cette ligne.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pourquoi dit-on « toucher le pactole » ?
vendredi 16 août 2024 • Duration 02:00
Si vous "touchez le pactole", vous avez beaucoup de chance. En effet, cela veut dire que vous avez gagné une grosse somme d'argent. Vous voilà donc très riche.
Mais d'où vient cette expression ? Pour en comprendre l'origine, il faut remonter assez loin, dans le temps comme dans l'espace. Il faut se transporter, plus précisément, au VIe siècle avant J.-C., dans un petit pays d'Asie Mineure, la Lydie.
Elle était alors gouvernée par un Roi nommé Crésus. Or, il s'aperçoit un jour que le lit de la rivière qui traverse son pays et arrose sa capitale, Sardes, est tapissé de sables aurifères.
Or, cette rivière s'appelait le Pactole. Depuis, être "riche comme Crésus", c'est devenir millionnaire, ou plus encore, et "toucher le pactole", qui est devenu un nom commun, c'est découvrir un trésor ou gagner le gros lot à la Loterie.
Une richesse peu utile
Reste une dernière question. Comment le Pactole s'est-il ainsi rempli d'or ? Pour trouver l'explication, il faut recourir, là encore, non à l'Histoire mais à la légende.
Elle nous raconte que le Roi Midas qui, au VIIIe siècle avant notre ère, régnait sur un autre pays d'Asie Mineure, la Phrygie, avait rendu service au dieu Bacchus. Pour le récompenser, celui-ci lui accorde une faveur : il transformera en or tout ce qu'il touchera.
Dès lors, Midas pense sa fortune assurée. Mais il s'aperçoit bien vite qu'il ne peut ni manger ni boire, car même l'eau et la nourriture se changent en or. Peu désireux de mourir de faim ou de soif, il demande l'annulation de son vœu. Pour l'obtenir, il doit se laver dans le Pactole, qui coule aussi dans son Royaume, voisin de la Lydie.
C'est alors que se seraient déposées au fond de la rivière les paillettes d'or qui allaient faire la fortune de Crésus.
D'après un autre récit, toujours issu de la mythologie, un fils d'Apollon, Chius, aurait plongé dans le Pactole, les poches remplies d'or. Il tentait ainsi d'échapper aux soldats de Crésus, à qui il aurait dérobé un trésor.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pourquoi les films sortent-ils le mercredi ?
vendredi 7 juin 2024 • Duration 01:46
Si vous avez l'habitude d'aller au cinéma, vous savez que le jour de sortie des films est le mercredi, un jour attendu avec impatience par les cinéphiles. Mais il n'en a pas toujours été ainsi.
À cet égard, la France est d'ailleurs plutôt une exception, avec la Belgique. En effet, les films sortent le jeudi en Italie comme en Allemagne. Quant aux spectateurs anglais et américains, c'est le vendredi qu'ils découvrent les nouveaux films. En quoi ils sont imités par de nombreux pays.
Ce qui n'a rien d'étonnant. En effet, le début du week-end peut paraître une période plus propice à la sortie des nouveaux films. Certains professionnels français plaident d'ailleurs pour l'adoption de ce modèle anglo-saxon.
Jusqu'à la fin des années 1930, le jour de sortie des films, en France, était fixé au vendredi. Cela donnait le temps aux exploitants de préparer leur programme pour le dimanche. C'est durant ce seul jour de repos hebdomadaire, en effet, que les salles étaient le plus remplies.
Puis, peu à peu, le jour de sortie est décalé au jeudi, puis au mercredi. La généralisation de la semaine de 40 heures, une des conquêtes du Front populaire, et l'habitude, de plus en plus répandue, de ne pas travailler le samedi, ôtent de son importance au dimanche.
Par ailleurs, durant ces quelques jours avant le week-end, les spectateurs vont entendre parler des films sortis. Ce qui leur laisse plus de temps pour faire leur choix.
Après la Seconde Guerre mondiale, les films sortent à nouveau le jeudi. Un jour qui paraît d'autant plus opportun que les enfants, qui représentent une partie notable des spectateurs, ne vont pas à l'école le jeudi.
Puis, en 1972, ce jour de relâche est fixé au mercredi. Un jour aussitôt adopté par les distributeurs pour la sortie de leurs films. Il n'a pas changé depuis, les enfants continuant de fréquenter les salles obscures et d'y entraîner leurs parents. En effet, les 3-14 ans représentaient, en 2022, près de 18 % de la clientèle des cinémas.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Qu'est-ce que le syndrome de l'étudiant en médecine ?
jeudi 7 octobre 2021 • Duration 02:04
Les jeunes gens voulant devenir médecins sont assez souvent victimes d'un trouble qui, par son objet, a reçu le nom de "syndrome de l'étudiant en médecine". Mais de quoi s'agit-il au juste ?
La manie du diagnostic
Durant ses longues études, l'étudiant en médecine est amené à découvrir l'origine et le développement des nombreuses maladies qui affectent la santé humaine. À chaque fois, ses professeurs en détaillent les symptômes.
Il peut arriver que certains étudiants fassent le rapprochement entre ces signes cliniques et la légère douleur qu'ils ressentent, croient-ils, à l'endroit précis de leur anatomie où la maladie qu'on vient de leur décrire se déclare le plus souvent.
Il arrive aussi à ces étudiants d'établir un tel diagnostic pour les autres. Ce syndrome se manifeste plus volontiers au cours de la première année d'étude, où l'afflux de connaissances nouvelles peut désorienter le futur médecin.
Le fait de concentrer son attention sur une manifestation bénigne, comme des fourmillements ou une petite brûlure, peut en accentuer l'intensité, et confirmer, dans l'esprit de l'étudiant, la véracité de son diagnostic.
Un trouble à prendre au sérieux
Ce syndrome de l'étudiant en médecine, qui peut faire sourire, ne doit pourtant pas être pris à la légère. D'abord parce qu'il provoque souvent une réelle anxiété chez celui qui en est la victime.
Même si tous les spécialistes ne s'accordent pas sur ce point, ce syndrome peut également déboucher sur une véritable hypocondrie, qui peut perturber la vie du patient.
Si ce trouble doit être pris au sérieux, c'est aussi en raison des dangers qu'il peut faire courir, au patient lui-même et à son entourage. En effet, l'inexpérience de l'étudiant, jointe à la conviction qu'il vient de dépister une maladie, peut conduire à de faux diagnostics.
Dans ce cas, les personnes qui s'y laissent prendre peuvent mettre leur santé en danger. Ce trouble psychologique à part entière, peut-être dû à une trop grande tendance à l'empathie, doit donc être pris en charge.
Le patient peut être amené, dans le cadre de certaines thérapies, à prendre conscience du caractère erroné de ses pensées et à en redresser le cours. Un suivi psychiatrique peut être aussi envisagé.
Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Comment fabriquer des briques sur Mars ?
jeudi 7 octobre 2021 • Duration 02:01
Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Que peut-on admirer au “musée de l'échec” ?
mercredi 6 octobre 2021 • Duration 01:52
En général, ce sont les réussites commerciales qui ont droit aux feux de l'actualité. Comme les échecs sont rarement mis à l'honneur, un original musée suédois a décidé de présenter les plus emblématiques.
Des produits qui n'ont pas trouvé leur public
En juin 2017, un musée insolite a ouvert ses portes dans une petite ville de Suède. Ce que vous trouverez dans ses vitrines, ce sont quelques spécimens des plus retentissants échecs commerciaux des dernières décennies.
On y trouve de curieux objets, comme ces lunettes sans branches, qui ne pouvaient tenir qu'à l'aide d'aimants placés sur le visage. Un masque électrique inspiré d'une série télévisée, et censé rajeunir ceux qui le portent, y voisine avec une poupée en haillons qui n'a eu aucun succès auprès des petites filles.
Le "musée de l'échec" expose également des exemplaires d'un téléphone qui pouvait se transformer en console de jeux ou d'un stylo réservé aux femmes.
Certaines personnalités sont à l'honneur dans ce palmarès de l'échec. C'est le cas de Donald Trump qui, entre son jeu de société et sa marque de vodka, n'a pas enregistré que des succès.
Certains de ces objets sont assez incongrus, mais d'autres auraient pu s'imposer. Ce qui prouve que personne ne peut prévoir l'évolution des goûts du public.
L'acceptation de l'échec
Il n'est guère étonnant que le fondateur de ce curieux musée ne soit pas soutenu par les industriels. Dans des sociétés où la culture du succès tient une place aussi centrale, il n'est pas facile, pour une entreprise ou un individu, d'avouer ses échecs.
C'est pour leur permettre de les confesser, s'ils le souhaitent, que le créateur du musée a prévu un lieu spécial, réservé à ces aveux, confidentiels ou publics. Certains s'y plaignent de leurs échecs personnels, d'autres avouent leurs déconvenues professionnelles.
Pour alimenter les vitrines de son musée, son fondateur fait appel aux dons. Il en reçoit de façon régulière. Ce "musée de l'échec" s'est ouvert dans un pays, la Suède, reconnu comme l'un de ceux qui encourageaient le plus la créativité. Pour lui, sans doute, elle passe aussi par l'acceptation de l'échec.
Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pourquoi parle-t-on de “ploutocratie” ?
mardi 5 octobre 2021 • Duration 02:08
À l'inverse de la démocratie, où la souveraineté appartient au peuple, donc à l'ensemble des citoyens, certains régimes politiques, comme la ploutocratie ou l'oligarchie, réservent le pouvoir, en droit ou en fait, aux plus riches ou à une minorité de personnes.
Le pouvoir aux plus riches...
Le terme de "ploutocratie" a été forgé à partir de deux mots grecs : "ploutos", qui désigne le dieu de la richesse, et "kratos", qui signifie "pouvoir".
La ploutocratie est donc un régime dans lequel le pouvoir appartient aux riches. Il tire son origine d'une pièce d'Aristophane, du IVe siècle avant J.-C., dans laquelle apparaît ce dieu de la richesse.
À vrai dire, aucun régime politique ne réserve le pouvoir, de manière formelle, aux citoyens les plus fortunés. Il s'agit plutôt d'une situation de fait, dans laquelle on voit la majorité des postes de direction politique et économique monopolisés par les personnes les plus aisées.
...Ou à une minorité
"Oligarchie" vient des mots grecs "oligos", ce qui veut dire "peu nombreux" et "arkho", qui signifie "commandement". Il s'agit donc du pouvoir d'une minorité.
À la différence de la ploutocratie, l'oligarchie n'est pas toujours une situation de fait; en effet, elle a souvent constitué la base officielle de certains régimes politiques.
Elle se rapproche parfois de la ploutocratie. En effet, dans les régimes censitaires, comme celui de la Restauration en France, le droit de vote est conditionné par le paiement de certains impôts. Mais seule la richesse foncière étant vraiment prise en compte, des personnes riches, mais non propriétaires terriens, se voyaient privées de l'exercice de la souveraineté.
Dans l'Athènes classique, aux Ve et IVe siècles avant notre ère, seuls les citoyens avaient le pouvoir. Pour être citoyen, il fallait être né, dans le cadre d'un mariage légitime, de deux parents eux-mêmes citoyens.
Dans les régimes monarchiques traditionnels, les fonctions les plus importantes étaient, pour l'essentiel, aux mains de la noblesse. Il s'agit donc d'une forme de régime oligarchique, dénommé "aristocratie".
Mais ce sont également quelques familles qui se partagent le pouvoir et l'influence dans certains régimes républicains, comme celui de Venise.
Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pourquoi les “Gueules cassées” ont inventé le Loto ?
lundi 4 octobre 2021 • Duration 01:57
L'Union des blessés de la face et de la tête, familièrement appelée les "gueules cassées", a, depuis ses origines, développé une relation étroite avec les jeux préférés des Français. Ainsi, c'est cette association d'anciens combattants qui a eu l'idée du Loto.
De la Loterie nationale...
Durant la Iére Guerre mondiale, de nombreux soldats sont victimes de blessures qui les défigurent. Connue sous le nom de "Gueules cassées, une association est créée pour leur venir en aide.
Pour compenser l'absence de pension spécifique pour les blessés du visage, l'association veut leur apporter un secours matériel. Et elle ne manque pas d'imagination pour trouver les ressources nécessaires.
Dans les années 1930, elle lance ainsi une souscription. Elle se présente sous la forme d'une tombola, qui permet aux participants de gagner des lots variés, les plus chanceux remportant même un avion de tourisme !
Le succès est tel qu'il donne des idées à l'État. S'inspirant de la tombola des "Gueules cassées", il crée, en 1933, la Loterie nationale. Ses bénéfices doivent aller en priorité aux invalides de guerre et aux anciens combattants.
...Au Loto
Mais, dans les années 1960, les finances de l'association accusent une baisse sensible. En effet, la Loterie nationale doit faire face à un redoutable concurrent, le tiercé, mis au point en 1954. Très vite, il devient en effet le roi des paris et remporte un succès grandissant.
Les responsables des "Gueules cassées" ne manquant pas de ressources, ils imagine une solution pour redresser la situation. Elle prend la forme d'un nouveau jeu, le Loto. Il s'agit d'une forme de tombola, dans laquelle les joueurs peuvent choisir 6 numéros, sur une grille en comportant 49.
Lors du tirage, les numéros gagnants sont indiqués par des boules extraites d'une sphère de plexiglas. Le nouveau jeu naît en 1975, avec un premier tirage l'année suivante.
Il suscite la création de la Française des Jeux, à laquelle l'association d'anciens combattants demeure étroitement associée. Avec un peu plus de 9 % du capital de la société, les "Gueules cassées" en sont en effet l'actionnaire privé le plus important.
Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pourquoi George Sand à Alfred de Musset ont-ils utilisé la stéganographie ?
dimanche 3 octobre 2021 • Duration 02:03
Les hommes, notamment durant les guerres, ont toujours rivalisé d'ingéniosité pour cacher de précieuses informations à ceux qui pourraient en tirer profit. On connaît l'art de la cryptographie, mais on ignore souvent celui de la stéganographie. Il est pourtant utilisé depuis l'Antiquité, et par des personnalités aussi célèbres que George Sand et Alfred de Musset.
Un message à l'intérieur d'un autre message
La cryptographie consiste, pour écrire un message, à utiliser un code spécifique. Seul ceux qui le connaissent pourront le déchiffrer. La stéganographie a recours à un autre moyen.
Le message n'est pas crypté, mais inséré dans un autre message. Là encore, cependant, pour comprendre le sens de ce message tapi à l'intérieur d'un autre, et qui a une toute autre signification, il faut en posséder la clef de lecture.
La stéganographie est utilisée depuis l'Antiquité, toutefois de manière un peu différente. Ainsi, en Chine, le message était écrit sur un support de soie, avant d'être placé dans une boule de cire, que le messager avalait. Elle était ensuite récupérée par les "voies naturelles".
Une correspondance truquée
George Sand et Alfred de Musset entament, en 1833, une liaison passionnée qui durera deux années. Les scènes de ménage y succèdent aux serments d'amour.
Les deux amants échangent de nombreuses lettres. Elles ne sont pas seulement remplies de déclarations enflammées et de vers bucoliques. Elles expriment aussi les exigences d'une passion très charnelle.
Comme les deux tourtereaux craignent que cette correspondance ne tombe sous des yeux indiscrets, ils la truquent. Autrement dit, ils recourent à la stéganographie.
Ainsi, certaines lettres de George Sand expriment a priori des sentiments romantiques. Personne ne pourrait en trouver le contenu déplacé. Mais si on ne lit qu'une ligne sur deux, on découvre un tout autre texte.
L'auteur de "La petite Fadette" y avoue, de manière très crue, sa folle envie de coucher avec le poète. Et celui-ci accepte sans façons, dans une réponse où, pour comprendre son intention, il ne faut lire cette fois que le premier mot de chaque phrase. Et George Sand de fixer le rendez-vous en employant le même stratagème.
Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.